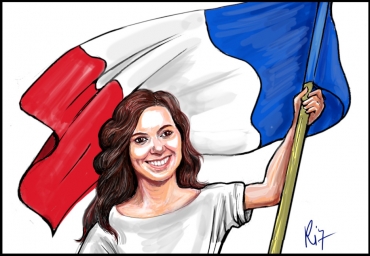lundi, 09 février 2026
Le parti de la guerre

Il y a chez Alain de Benoist outre une réflexion solide, pertinente et originale mais surtout pleine de bon sens, étant entendu qu’il s’en tient à la réalité des faits et non aux fantasmagories d’idéologies faisandées. Ainsi en va-t-il de la guerre en Ukraine où les gouvernants de tous les pays européens jouent les va-en-guerre contre la Russie et laisse à penser que l’Ukraine peut gagner la guerre. Ce qui est faux, les Ukrainiens l’ont perdu et l’état même de leur armée n’est pas en mesure de résister encore longtemps. Tel est la réalité des faits que les Européens refusent de voir, allant jusqu’à vouloir nous faire croire que les Russes vont envahir l’Europe sous peu. Mais les Européens n’iront pas se battre pour l’Ukraine pas plus qu’ils ne voulaient le faire pour Dantzig. Nous sommes gouvernés par des pousse-au-crime. Le danger ce ne sont pas les peuples mais Bruxelles et ses dirigeants.
Lire la suite ICI
Source : revue Eléments, n°218, mars 2026.
11:07 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
dimanche, 08 février 2026
Un Puy du Fou de gauche

Michel Onfray
J’ai jadis acheté chez un bouquiniste un manuel scolaire publié en 1949 sous le titre Premier Livre d’Histoire de France. Il servait aux élèves des cours élémentaires. On doit ce livre à Jacques Fuster, inspecteur d’académie, agrégé d’histoire, et à A. Lebrun, instituteur, directeur d’école d’application. Ce monsieur Fuster a fait ses études à l’École alsacienne, au lycée Louis-le-Grand, à la Sorbonne, il a collectionné nombre de médailles qui attestent de sa notabilité, c’est le mon- sieur Boucheron de l’époque. Il est mort en 1974. L’ou- vrage est préfacé par Albert Bayet, normalien, agrégé, docteur, professeur à la Sorbonne et à l’École pratique des hautes études, radical-socialiste, membre de la Ligue des droits de l’homme et de l’Union rationaliste. Cet homme de gauche défendait la mission civilisatrice de la France dans les colonies. Lors des procès de Moscou, entre 1936 et 1938, on le retrouve compagnon de route du PCF. Un autre Boucheron.
Dans ce manuel, voici comment la féodalité est enseignée aux enfants : des châtelains qui s’ennuient devant d’immenses cheminées dans lesquelles brûlent « des troncs d’arbre entiers » jouent, mangent des venai- sons en présence de serviteurs, de troubadours, de montreurs d’ours, de joueurs de harpe et de conteurs.
En face, « les opprimés » : les paysans mangent des glands comme les cochons, dorment sur un lit de feuilles sous des huttes de branchages.
Parfois le seigneur descend de son château pour ravager les terres du paysan nommé Jacques Bon- homme qui nourrit le seigneur et sa cour. La maladie et la famine règnent. Voici le plus beau : « Les uns mangent l’herbe des chemins, les autres déterrent les cadavres dans les cimetières ou attaquent les passants pour s’en nourrir » – c’est une citation, on la trouve en page 29 !
L’Éducation nationale républicaine enseigne aux chères têtes blondes d’alors que la monarchie française génère cannibalisme et nécrophagie ! La fake news n’est pas nouvelle, la preuve, celle-ci date de 1949 : à l’époque, il faut flatter les communistes dans le sens du poil soviétique.
La Révolution française abolit ce monde dans lequel les pauvres... mangent leurs morts. Rien, bien sûr, sur les massacres de Septembre, la Loi sur les suspects, le gouvernement révolutionnaire avec son tribunal, la guillotine, les 20 000 morts de la Terreur, les 200 000 du génocide vendéen, ce qui serait raconter les faits.
Les auteurs de gauche continuent leur récit avec un éloge des bienfaits de la colonisation : « Les Français, dans toutes leurs colonies, multiplient les écoles et les grands travaux (ports, routes, chemins de fer) ; nos médecins protègent les habitants contre les maladies ; nous essayons, en tous points, d’améliorer le sort des indigènes. » Algérie comprise.
Ce manuel républicain fournit à monsieur Ruffin une partie de la feuille de route de son Puy du Fou de gauche. Le reste serait à l’avenant.
Source : Journal du dimanche 8/2/2026
10:42 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
mercredi, 04 février 2026
L’heure des petits prédateurs

Vincent Trémolet de Villers
Ces histoires devenues courantes de gendarmes percutés, cette policière traînée à Argenteuil sur plusieurs dizaines de mètres, est-ce dérisoire, peut-être même un peu vulgaire, pour ne pas devenir immédiatement une inquiétude générale, une cause nationale ? Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, veut que la France résiste à « la brutalisation du monde », c’est un noble projet, mais la brutalisation de la vie quotidienne des Français, l’extrême violence qui menace les policiers ne sont pas moins urgentes. Toutes les vingt minutes, un citoyen refuse d’obtempérer et bafoue l’État français dans son autorité.
Les petits prédateurs de quartier imposent la tyrannie de leurs pulsions au mépris de la vie des policiers et des gendarmes. La drogue, la délinquance, l’islamisme ont séparé des quartiers entiers de la République française, et les séparatistes transportent avec eux leur arrogance, leur sentiment d’impunité, leur haine du pays dans lequel ils vivent. Ils le font avec bonne conscience puisque la gauche morale les présente en victimes d’une police répressive, d’un État arbitraire. Quand, à Mulhouse, des étudiants d’une école d’art détruisent une piñata en forme de voiture de police, nous ne sommes plus dans l’anarchisme poétique d’un Georges Brassens, mais dans l’ivresse de la meute qui s’acharne sur le dernier reliquat de l’autorité : la police.
Pas de malentendu, le fracas du monde implique une mobilisation constante de ceux qui nous gouvernent, mais elle apparaîtra comme une diversion si rien n’est fait pour mettre fin au chaos intérieur. Laurent Nuñez dit qu’il ne s’agit en rien d’un « échec », mais, quand les voyous n’ont plus peur de la police, de la justice, de la sanction, où est le succès ?
La vérité, c’est que tout le monde a en tête les conséquences de la mort dramatique du jeune Nahel Merzouk suite à un refus d’obtempérer. Quatre jours d’émeutes dans toute la France, 12 000 voitures brûlées, des centaines de bâtiments incendiés, 45 000 forces de l’ordre mobilisées. Pour éviter une nouvelle explosion, le pouvoir met la violence sous le tapis des périls extérieurs, concentre ses efforts sur la question des réseaux sociaux. L’ordre public attendra 2027… La police et les Français, pourtant, ne veulent pas attendre : la chienlit, c’est maintenant.
Source : Le Figaro 4/02/2026
09:39 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
lundi, 02 février 2026
Aux Européens de gérer la question russe

Thomass Gomart est le directeur de l’Institut français des relations internationales. Il vient de publier un ouvrage, Qui contrôle qui ? (Tallandier). Où il analyse en historien les nouveaux antagonismes qui régissent le monde et donne des pistes pour penser l’avenir. Dans le chaos actuel, les Européens vont devoir gérer l’émergence de ces nouveaux empires que sont l’Amérique, la Chine, l’Inde et la Russie. Mais sommes-nous armés pour le faire ?
Lire la suite ICI
Source : La Tribune dimanche 1/02/2026
08:58 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
dimanche, 01 février 2026
Tous contre Trump. Les lâchetés françaises

Une fois de plus, Pascal Praud, chroniqueur avisé du Journal du dimanche met le doigt où ça fait mal, à sa voir sur nos propres lâchetés non seulement médiatiques mais également sociétales. Ah, cette bonne presse qui met sur un pied d’égalité un mort à Minneapolis et 35 000 morts en Iran. Cette même presse qui passe sous silence les victimes au profit des assassins. Ainsi va la France d’aujourd’hui avec la complicité d’une pseudo élite qui ne cessent de nous faire prendre les vessies pour de lanternes.
Lire la suite ICI
Source : Le Journal du dimanche 01/02/2026
11:17 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
samedi, 31 janvier 2026
Insécurité et délinquance : les chiffres officiels publiés en 2026 pour 2024

Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié dans son édition de 2025 des Chiffres clés de l’insécurité et de la délinquance un document de référence qui dresse un panorama complet des crimes et délits enregistrés en France en 2024 par la police et la gendarmerie nationales. Ces données, définitives, permettent de mesurer précisément l’évolution des violences, des vols, des escroqueries et du sentiment d’insécurité ressenti par la population.
Violences : une progression marquée depuis plusieurs années
En 2024, 976 homicides ont été enregistrés en France, un chiffre en légère baisse sur un an (-2 %), mais qui reste supérieur aux niveaux observés au milieu des années 2010. Les tentatives d’homicide, en revanche, poursuivent leur hausse avec 4 290 victimes, soit +7 % sur un an et +8 % en moyenne annuelle depuis 2016.
Les violences physiques enregistrées atteignent près de 450 000 victimes, en augmentation continue depuis huit ans (+6 % par an depuis 2016). Les violences sexuelles, quant à elles, concernent 122 400 victimes, dont 46 100 viols ou tentatives de viol, avec une hausse annuelle de 9 % en 2024 et de 15 % en moyenne depuis 2016.
Violences intrafamiliales et conjugales : des volumes très élevés
Les violences intrafamiliales représentent une part importante des faits enregistrés. En 2024, 272 400 victimes de violences conjugales ont été comptabilisées, un niveau stable par rapport à l’année précédente mais en hausse structurelle depuis 2016 (+10 % par an). 84 % des victimes sont des femmes, et 86 % sont de nationalité française.
Les violences physiques intrafamiliales touchent particulièrement les mineurs : 48 % des victimes de violences intrafamiliales non conjugales sont mineures, un chiffre qui souligne le poids de ces infractions dans le cadre familial.
Vols et atteintes aux biens : des tendances contrastées
Les vols sans violence contre les personnes concernent plus de 607 000 victimes, tandis que les vols violents sans arme atteignent 48 300 faits, en baisse sur l’année mais à un niveau toujours supérieur à celui observé dix ans plus tôt.
Les vols de véhicules poursuivent leur recul avec 137 600 véhicules volés, mais les vols et dégradations liés aux véhicules restent élevés, avec 352 100 faits recensés. Les cambriolages de logement s’élèvent à 218 200 infractions, un niveau globalement stable.
Les escroqueries et fraudes aux moyens de paiement représentent l’un des volumes les plus importants de la délinquance enregistrée, avec 417 300 victimes en 2024. Les infractions liées au numérique atteignent 398 700 faits, en hausse de 11 % sur un an et de 12 % par an depuis 2016. Près des deux tiers concernent des atteintes aux biens facilitées par l’usage d’outils numériques.
Mis en cause et élucidation : des écarts importants selon les infractions
Les taux d’élucidation varient fortement selon la nature des crimes et délits. Les homicides affichent un taux d’élucidation de 79 %, contre 55 % pour les violences physiques et seulement 16 % pour les violences sexuelles. Les vols, notamment sans violence, restent très faiblement élucidés, avec des taux compris entre 6 % et 7 %.
En 2024, 290 600 personnes ont été mises en cause pour usage de stupéfiants, un chiffre en hausse de 11 % sur un an, tandis que 52 300 mis en cause concernent le trafic de stupéfiants.
Géographie de la délinquance : une concentration urbaine marquée
La délinquance enregistrée reste fortement concentrée dans les zones urbaines. Les 22 principales métropoles regroupent plus de 80 % des victimes, et l’Île-de-France concentre à elle seule 58 % du total des victimes, alors qu’elle représente environ 19 % de la population nationale.
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) affichent des taux de violences et de vols sensiblement supérieurs à la moyenne nationale pour de nombreuses infractions.
Le sentiment d’insécurité continue de progresser. En 2024, 15 % des Français déclarent se sentir en insécurité à leur domicile, 22 % dans leur quartier ou leur village, et 42 % dans les transports en commun. Cette perception est particulièrement marquée chez les jeunes de 18 à 24 ans, les chômeurs et les habitants des QPV.
La satisfaction à l’égard de l’action des forces de sécurité intérieure atteint 56 % au niveau national, un chiffre relativement stable, mais qui masque de fortes disparités selon les territoires et les profils sociaux.
Source : breizh.info
10:26 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
jeudi, 29 janvier 2026
Violées, torturées et tuées : en France les femmes sont surtout victimes de la diversité !
Cyrano
L'éditorial de Riposte laïque de ce matin
Il y a quelques jours à Nice (Alpes-Maritimes), une femme de quatre-vingt-dix ans, croyant ouvrir à son infirmière, s’est retrouvée face à un prédateur tunisien de vingt-neuf ans sous OQTF et assigné à résidence en Saône-et-Loire. Sans doute n’avait-il pas les codes géographiques ?! Cet individu squattait depuis quelque temps à côté de chez sa victime, c’est-à-dire qu’il avait repéré sa proie avant de perpétrer son viol abject.
Côté médias, dans l’ensemble, il ne s’est rien passé puisque la discrétion dont ils ont fait preuve dans cette affaire est exemplaire. Il faut dire que le bourreau appartenait à la caste sacrée de la diversité et, de ce fait, malgré son crime atroce envers une personne aussi fragile, il était presque justifié. Aucune association de gauche ne viendra donc soutenir cette pauvre nonagénaire, contrairement aux migrants et autres braves hommes venus d’un ailleurs idéalisé et qui peuvent compter sur la Licra ou SOS Racisme. Cette dernière officine raciste anti-Blancs est plus occupée à imposer coûte que coûte aux loueurs la présence de diversitaires, dont on sait combien ils sont vaillants pour pourrir la vie d’un quartier une fois dans la place.
Et pendant que le millionnaire Victor Wembanayama, joueur de basket dans la prestigieuse équipe des Spurs de San Antonio aux États-Unis et chouchou star de la NBA – National Basketball League –, fait une grosse colère d’enfant gâté face à la politique d’immigration de l’administration Trump – que la France devrait imiter ! –, chez nous des femmes de tous âges sont la proie de monstres issus pour une bonne part de la diversité, Philippine ou Lola – une enfant dans ce cas – en sont les exemples les plus tristement connus. Personne pour le reconnaître, au contraire, car énoncer cette vérité c’est se rendre coupable du crime de lèse-diversité.
Pourtant, il suffit d’éplucher la presse régionale ou de se rendre dans les tribunaux – dont les magistrats son si compréhensifs à l’égard des venus d’ailleurs ! – pour découvrir la réalité cachée, envers et contre toutes les affirmations du contraire de la part des féministes vendues à la cause anti-Blancs. Des féministes qui érigent Gisèle Pelicot en héroïne de la lutte des femmes mais qu’elles auraient agonie d’injures si, par « malheur », son mari avait été noir ou maghrébin !
Pour prévenir toute forme d’accusation de racisme interdit – celui contre les Blancs étant non seulement autorisé mais encore valorisé, notamment chez LFI ! –, on peut aussi affirmer que toutes les femmes sont victimes de la prédation diversitaire, qu’elles soient blanches ou pas, selon la distinction simpliste des antiracistes, étant donné que certaines Algériennes sont plus blanches que des Calabraises ! Ainsi, exemple parmi tant d’autres, une certaine Fatima O a été agressée sexuellement en novembre 2025 par un Soudanais à Toulouse (Haute-Garonne). Cliquez ici.
Dernière abomination en date, dans la région de Lyon (Rhône), une adolescente de quinze ans, placée en foyer, est tombée dans un guet-apens organisé par son ex petit-ami et quelques complices femmes qui l’ont torturée, en la scarifiant et la brûlant, des méthodes qu’Ilan Halimi avait subies lors de son enlèvement par le gang des barbares dirigé par un certain Youssouf Fofana, ce qui ne sonne pas trop berrichon ! Aussi, sans en savoir plus à l’heure où ces lignes sont écrites, on peut supposer que l’origine des bourreaux de la jeune fille ne fait pas trop de mystère. Cliquez ici.
Il serait temps de reconnaître que, pour autant qu’il existe des prédateurs blancs, la prédation africaine relève d’une culture de la prédation envers les femmes, précisément. L’Afrique est le continent où les femmes sont le plus victimes de violences et de meurtres. En 2023, selon un rapport de l’ONU, il y a eu « 51.100 féminicides dans le monde, dont 21.700 rien qu’en Afrique (mais ce chiffre pourrait atteindre près de 30.000, selon une fourchette haute). » L’explication pourrait être autant ethnique que religieuse, à condition d’étudier le phénomène sans œillères idéologiques de gauche. Cliquez ici.
Malgré les faits criants, les féministes françaises préfèrent dézinguer le festival d’Angoulême (Charente), jugé trop « toxico-sexiste » et pas assez inclusif, enfin toute la logorrhée habituelle de l’ultragauche dégénérée. Résultat, le Festival international de la bande dessinée est annulé pour l’année 2026, ce qui ne rendra pas les « autrices » hystérisées par la présence des « mâles blancs » plus douées que Moebius, Manara ou Pratt ! Cliquez ici
Voilà où se situe le combat de ces hypocrites fanatisées qui ne défendent en rien les femmes, lesquelles continuent à être massacrées par des individus incompatibles avec notre identité culturelle. Toutes choses dites sans généraliser évidemment et surtout pour épargner à des Alain Jacubowitcz de devoir quitter leur jacuzzi pour une énième lutte antiraciste de prétoire contre Riposte laïque ! D’autant que Mila, une jeune femme menacée de mort par les machos coraniques, vient de recevoir une plainte de la Licra, qui n’a honte de rien, selon l’adage : « Tant qu’il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir. »
Cependant, la digue se fissure et l’on peut saluer à ce propos le témoignage de la jeune Suzanne diffué dans l’émission « Sept à Huit » dimanche soir dernier sur TF1, racontant son supplice infligé par un homme noir africain. Une Suzanne pas particulièrement blonde aux yeux bleus, au passage, et non moins ravissante : cliquez là.
En attendant, des femmes meurent en France sous les coups de la diversité, c’est une réalité qu’aucun tribunal ni aucun idéologue de gauche ne peuvent plus faire taire…
Source cliquez ici
14:50 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
Après la tornade Trump

Le Forum mondial de Davos a été révélateur du chaos mondial. Le discours du président américain a été à la heuteur des craintes qu’il suscitait, mais celui du Premier ministre canadien, Mark Carney, fera date par sa clairvoyance. Pierre Lellouche nous explique pourquoi dans sa chronique à Valeurs actuelles.
Lire la suite ICI
Source : Valeurs actuelles, 28/1/2026
09:59 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
mercredi, 28 janvier 2026
Stupide droite européenne trumpiste

Réélu à la Maison-Blanche, Donald Trump n’a pas seulement retrouvé le pouvoir : il a accéléré une rupture historique déjà amorcée lors de son premier mandat. En quelques mois, ses décisions ont ébranlé les fondements de l’ordre international issu de la fin de la guerre froide, provoquant stupeur et déni, en particulier en Europe. Découplage stratégique avec le Vieux Continent, remise en cause de l’OTAN, abandon du multilatéralisme et affirmation sans fard des rapports de force : le trumpisme version 2.0 assume désormais la fin des illusions morales qui structuraient l’« Occident collectif ».
Pour Alain de Benoist, cette séquence marque bien plus qu’un simple changement de style ou de personnel politique. Elle acte l’entrée dans un monde multipolaire, brutal, débarrassé des discours universalistes, où l’Europe apparaît plus dépendante et plus désarmée que jamais. Dans cet entretien approfondi, le philosophe analyse les conséquences durables de ce basculement géopolitique et les impasses d’un continent qui refuse encore d’en tirer les leçons.
Lire la suite ICI
Source : breizh.info
10:24 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
samedi, 24 janvier 2026
« Nimier, c’est le dandysme en littérature » – Entretien avec Thierry Bouclier
Source Breizh-Info cliquez ici
Libre, insolent, irrévérencieux : Roger Nimier continue de troubler les conformismes littéraires et moraux. Dans cet entretien accordé à Breizh-info, Thierry Bouclier, auteur du livre sur l’auteur paru dans la collection Qui suis-je ? revient sur l’héritage du romancier, trop souvent réduit au cliché du « chef des hussards ». Il évoque un écrivain inclassable, étranger aux idéologies, amoureux de ce qu’il est désormais interdit d’aimer – les femmes, l’alcool, la vitesse – et farouchement hostile aux polices de la pensée. À travers Les Épées, Le Hussard bleu, ses chroniques acérées et ses combats pour la littérature contre la morale, Bouclier dessine le portrait d’un mousquetaire des lettres, rétif au « récit officiel » et au terrorisme intellectuel. Une plongée dans l’esprit nimérien, entre impertinence et mélancolie, élégance et danger, pour comprendre pourquoi, aujourd’hui encore, Nimier reste nécessaire.
Breizh-info.com : Pourquoi Nimier aujourd’hui ? Qu’est-ce qui, selon vous, manque à notre époque et que Nimier peut encore apporter – sur le style, l’esprit, la liberté d’écrire ?
Thierry Bouclier : L’œuvre de Nimier est empreinte d’une liberté de ton, d’une insolence et d’une irrévérence pour les idoles de son époque. Il ne se prenait pas au sérieux et pratiquait une ironie mordante. Même s’il était incontestablement un homme de droite, il était tout, sauf un idéologue. Il était étranger à tout sectarisme. Il n’était pas de son siècle, et encore moins du nôtre. Je le vois comme amoureux de tout ce qu’il est aujourd’hui interdit d’aimer, les femmes, l’alcool et la vitesse. Il a été vu comme un hussard. Sans doute. Mais plus encore comme un mousquetaire.
Breizh-info.com : On réduit souvent Nimier au “chef des hussards”. Qu’est-ce que cette étiquette éclaire vraiment, et qu’est-ce qu’elle cache de l’homme et de l’œuvre ?
Thierry Bouclier : Il n’a effectivement jamais été « chef des hussards » pour la simple raison que les hussards, en tant que courant littéraire structuré, n’ont jamais véritablement existé. Cette histoire résulte d’une mystification du critique Bernard Frank dans sa célèbre chronique, « Grognards et Hussards », parue en 1952, dans Les Temps modernes, la revue de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Nimier y est associé à Jacques Laurent et Antoine Blondin, avant d’être rejoint par Michel Déon.
En revanche, il a existé un esprit, mais également un style hussard, admirablement décrits par l’écrivain Pol Vandromme : « Le style du hussard, c’est le désespoir avec l’allégresse, le pessimisme avec la gaieté, la piété avec l’humour. C’est un refus avec un appel. C’est une enfance avec son secret. C’est l’honneur avec le courage et le courage avec la désinvolture. C’est une fierté avec un charme ; ce charme-là hérissé de pointes. C’est une force avec son abandon. C’est une fidélité. C’est une élégance. C’est une allure. C’est ce qui ne sert aucune carrière sous aucun régime. C’est le conte d’Andersen quand on montre du doigt le roi nu. C’est la chouannerie sous la Convention. C’est le christianisme des catacombes. C’est le passé sous le regard de l’avenir et la mort sous celui de la vie. C’est la solitude et le danger. Bref, c’est le dandysme. » Voilà un bon résumé de l’œuvre de Nimier.
Breizh-info.com : Les Épées choque encore par son irrévérence envers le “récit officiel”. Que dit ce roman de la France de l’après-guerre, et de ce que Nimier refuse d’avaler ?
Nimier, avec la fraîcheur de ses vingt années atteintes en 1945, comprend, pour reprendre la célèbre phrase de Brasillach, que « l’Histoire est écrite par les vainqueurs ». Ce qui s’écrit au lendemain de la guerre ne correspond pas à ce qu’il a vu et vécu pendant cinq ans. La France dressée et unie derrière le grand homme de Londres, les héros d’un côté et les traitres de l’autre, le parti des 75.000 fusillés, tout cela ne cadre pas avec la réalité. Il va donc l’écrire, dans Les Épées et Le Hussard bleu, non pas dans un esprit partisan ou de réhabilitation, mais pour choquer et respirer dans une atmosphère qui l’étouffe. On imagine sa réaction s’il revenait aujourd’hui et découvrait les dérives contemporaines du « récit officiel ».
Breizh-info.com : Nimier est souvent décrit comme anti-sartrien. Mais au fond, il combat quoi : une philosophie, une morale, une police des consciences, un système médiatico-universitaire ?
Thierry Bouclier : Un peu tout cela. On a oublié ce qu’a été, au lendemain de la guerre, la pesanteur « sartrienne » sur le monde intellectuel en général et celui des lettres en particulier. Sartre régnait en maître, alors même que son attitude sous l’Occupation avait été plus qu’ambigüe. Ayant accepté de se soumettre à la censure allemande et de laisser jouer Huit clos devant un parterre « vert-de-gris », il fait figure de grand épurateur à la Libération. Il incarne toute l’imposture de cette époque. Nimier se dresse donc contre que l’on appelle de nos jours le « terrorisme intellectuel ».
Breizh-info.com : Vous insistez sur le fait qu’il n’a pas été “diabolisé”. À vos yeux, est-ce d’abord une affaire de biographie (pas de Vichy), de mort jeune, ou de talent littéraire impossible à effacer ?
Thierry Bouclier : Assurément les trois. Il n’a jamais eu le moindre rapport avec le régime de Vichy. Cela aide à échapper au sceau de l’infamie. Une mort prématurée est également souvent un tremplin pour entrer dans la légende. Nous songeons à l’acteur James Dean ou au chanteur Eddie Cochran Mais si son œuvre avait été médiocre, son nom ne serait pas parvenu jusqu’à nous. Combien d’écrivains, pourtant talentueux, sont entrés dans un long purgatoire après leur mort ? Nimier a échappé à ce sort.
Breizh-info.com : Nimier a défendu des écrivains “compromis” en mettant la littérature au-dessus du reste. Où placez-vous la frontière entre jugement moral et jugement littéraire – et pourquoi cette question reste explosive ?
Thierry Bouclier : Nimier a contribué à ce que Jacques Chardonne, Paul Morand ou André Fraigneau, sacrifiés sur l’autel de l’Épuration, retrouvent toute leur place dans le monde de lettres. Et en 1957, il est à l’origine du retour de Céline sur le devant de la scène avec la promotion qui entoure D’un château l’autre. Evidemment qu’il faut savoir séparer l’homme de son œuvre. Faut-il encenser Aragon pour lire Aurélien ? Avoir leurs mœurs pour apprécier Montherlant ou Gripari ? Être un bouffeur de curés pour savourer Les Deux étendards ? Être alcoolique pour se délecter d’Un singe en hiver ? Être communiste pour écouter Jean Ferrat ? Nous pourrions multiplier les exemples à l’infini. Au nom d’un moralisme absurde et puritain, Brasillach est voué aux gémonies, quatre-vingt ans après sa mort, alors qu’il est un très grand écrivain.
Breizh-info.com : Il y a chez lui une tension entre l’impertinence et la mélancolie. Comment cette dualité s’exprime-t-elle concrètement dans ses livres, et chez quel personnage (Sanders ?) la voit-on le mieux ?
Thierry Bouclier : Cette dualité s’exprime notamment dans Le Hussard bleu et Les Enfants tristes, chez François Sanders et Olivier Malentraide, héros respectifs des deux romans. François Sanders, homme rempli de paradoxes, rejetant la violence tout en aimant frapper les plus faibles, à la fois attachant et détestable, tendre et bagarreur, romantique et grossier avec les femmes, religieux mais pas pieux, lisant Alexandre Dumas et se saoulant au gin, et portant ce jugement sur lui-même : « J’étais un type détraqué, depuis longtemps je le savais. Trop d’alcool, trop de sang, trop de XXe siècle dans le sang, trop de mépris. Avec ça, bien carré, capable de me conduire comme un autre, ça et là. » À ses côtés, son double et son contraire, le jeune et beau François Saint-Anne : « Ce ne sont pas tout à fait deux personnages distincts, parce que l’un comme l’autre connaissent bien Nimier. Dans la mesure où, comme le croyait Pascal, il y a deux hommes en nous, ils sont chacun l’un de ces hommes-là », a justement écrit Pol Vandromme.
Breizh-info.com : Nimier cesse d’écrire des romans pendant dix ans. Pourquoi ce silence romanesque, et qu’est-ce qu’il produit : maturation, déplacement vers la critique, stratégie, lassitude ?
Thierry Bouclier : Le conseil lui est donné par Jacques Chardonne, après la parution, en 1953, de son roman Histoire d’un amour, qui reçoit un accueil mitigé de la part de la critique. Nimier lui promet alors de ne rien publier pendant dix ans. Et il a tenu parole. Mais le sort a voulu que son retour dans le domaine du roman se produise après sa mort, avec la publication posthume de D’Artagnan amoureux ou Cinq ans avant. Un conseil sans doute judicieux qui a permis à Nimier de développer son talent de critique littéraire, comme en témoignent ses chroniques et articles rassemblés dans les deux tomes des Journées de lecture et L’Élève d’Aristote.
Breizh-info.com : Nimier scénariste et dialoguiste (Malle, etc.) : le cinéma a-t-il changé son écriture ? Et inversement, que reste-t-il de Nimier dans la culture cinéma de l’époque ?
Thierry Bouclier : Il reste un film, que je conseille à vos lecteurs de découvrir ou de revoir, Ascenseur pour l’échafaud, de Louis Malle, sorti en 1958. Avec Maurice Ronet – un monstre sacré du cinéma français, malheureusement quelque peu oublié -, Jeanne Moreau et Lino Ventura. Un jeu d’acteurs. Des dialogues. Une ambiance. Et la musique de Miles Davis. Du grand cinéma français. Un des meilleurs films de Louis Malle avec Le Feu follet, sorti en 1963, d’après le roman éponyme de Pierre Drieu la Rochelle.
Breizh-info.com : Pour un lecteur qui ne l’a jamais lu : par où commencer (un roman, un recueil de chroniques, un portrait) et quels pièges éviter pour ne pas “mal lire” Nimier (anachronisme, moraline, caricature politique) ?
Thierry Bouclier : Je conseillerai naturellement Le Hussard bleu, qui reste son meilleur livre. Un ouvrage qu’il faut lire à vingt ans. Ou plus tard, si la vie vous a fait passer à côté. Un véritable traité d’impertinence et d’insolence. Et pour les amoureux de la belle littérature et des grands écrivains, ses critiques littéraires, rassemblées dans les deux ouvrages cités ci-dessus.
Propos recueillis par YV
13:00 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
jeudi, 22 janvier 2026
C'était hier le 21 janvier, l'anniversaire de l'assassinat de Louis XVI
« La France ne peut abdiquer si facilement le privilège d’être une puissance maritime »
Source : Boulevard Voltaire cliquez ici
Le chef de la maison de Bourbon fait mémoire du roi, rappelle la vocation maritime et la grandeur mondiale de la France.
À l’occasion du 21 janvier, date anniversaire de la mort du roi Louis XVI, Louis Alphonse de Bourbon, duc d'Anjou, rend hommage à ce chef d'État qui avait - on l'ignore, bien souvent - une véritable vision stratégique pour la France. En cette année du 400e anniversaire de la Marine, le chef de la maison de Bourbon rappelle la vision stratégique et maritime du roi, fondement de la puissance et de la souveraineté françaises.
« Aujourd’hui, nous commémorons l’assassinat de mon ancêtre Louis XVI, décapité le 21 janvier 1793. Il ne s’agit en réalité pas que de faire mémoire de ce roi injustement décapité. Il faut également se souvenir ensemble de ce que les Français ont été capables de faire entre eux afin de tout faire pour ne plus jamais sombrer dans la tragédie de la guerre civile. Puisse le Ciel ne jamais permettre à la France de revivre de tels événements.
De plus, il faut comprendre que la lame qui a tranché le corps du roi en ce jour de janvier a mis fin à l’existence d’un homme d’État profondément attaché à maintenir à son plus haut degré la souveraineté française. Ainsi, cette année particulièrement, alors que nous allons célébrer les 400 ans de notre Marine et les 250 ans de la déclaration d’indépendance américaine, je voudrais insister sur la pertinence de la vision de Louis XVI relative à la place de la France dans le monde. En effet, il convient de rendre hommage à l’action énergique et intelligente de ce monarque en matière navale et maritime. Dès le début de son règne, il a continué patiemment l’œuvre de résurrection de la Marine royale entreprise par son grand-père, le roi Louis XV, suite à la terrible guerre de Sept Ans. Pour cela, il a su s’entourer des plus grands marins et administrateurs de son temps.
Ainsi, Louis XVI a sans doute donné à la France la Marine la plus redoutable qu’elle ait jamais eue. Plus que n’importe quel autre chef d’État, ce roi avait compris l’importance primordiale d’entretenir des escadres de haute mer, capables d’être présentes sur tous les océans. Loin d’enfermer la France dans une seule logique continentale, ce monarque avait compris que, par la mer, la France avait une vocation mondiale. Nos flottes du Ponant et du Levant étaient alors en mesure de se battre avec succès à la fois dans les Caraïbes, en Méditerranée et dans l’océan Indien tout en faisant craindre à l’Angleterre une menace d’invasion. Nos vaisseaux disposaient de points d’appui judicieusement répartis dans le monde, grâce à un réseau d’îles stratégiques et de comptoirs plus facilement défendables qu’un vaste empire colonial.
Aujourd’hui encore, la puissance maritime française repose principalement sur ces mêmes îles et territoires disséminés à travers le monde, même si les régimes qui succédèrent à la monarchie légitime en augmentèrent le nombre. Cependant, ces derniers mois, je constate avec inquiétude que la France semble vouloir se désintéresser de sa vocation maritime. J’en veux pour preuve la marche rapide vers l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie suite aux accords de Bougival de juillet 2025, ainsi que la controverse autour de la cession des îlots Hunter et Matthew. Alors qu’une partie de l’Histoire du monde s’apprête à s’écrire dans la zone indo-pacifique, le recul de la France dans cette région serait une erreur stratégique majeure et un signe de faiblesse criant qui encouragerait nos ennemis à accroître la pression sur nos possessions. J’invite nos dirigeants à bien mesurer l’importance de leurs décisions concernant ces territoires et à s’instruire des leçons de notre passé. La France ne peut abdiquer si facilement le privilège d’être une puissance maritime.
En faisant mémoire du roi Louis XVI, je souhaite que son exemple soit une source d’inspiration pour les responsables politiques, afin que notre pays ne subisse pas un déclassement honteux. En effet, je désire au contraire que, par une action énergique et ambitieuse, la France puisse continuer à être présente sur toutes les mers, défendant nos intérêts et ceux de nos alliés, comme nous l’avions fait il y a plus de 250 ans avec nos lointains cousins d’Amérique ! Le règne de Louis XVI est plus riche en enseignements que cette seule et terrible journée du 21 janvier. J’ai à cœur, et je suis certain que c’est ce qu’aurait voulu mon ancêtre, que la France puisse s’inspirer de son action et que, grâce à son souvenir, la Royale continue encore pendant longtemps de sillonner les mers, défendant l’honneur et l’intérêt de la France partout où elle se trouve.
Que saint Louis protège notre cher pays ! »
Un peu partout en France des messes ont été dites le 21 janvier pour le repos de l'âme du Roi Louis XVI. Ce fut aussi le cas dans le Trégor où une soixantaine de personnes y ont assistée.
18:10 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
mercredi, 14 janvier 2026
Groenland, l’épreuve de vérité de l’Europe
Le Groenland n’a jamais été une terre vierge ni paisible. Bien avant l’arrivée des Danois, les populations originelles qui occupaient l’île furent éliminées ou refoulées par des vagues venues de l’Arctique nord-américain. Les Inuits, tels que nous les connaissons aujourd’hui, ne furent pas les premiers habitants du Groenland, ils furent des conquérants tardifs, porteurs de techniques adaptées au froid extrême, qui supplantèrent les cultures antérieures. Avant eux encore, les Vikings avaient établi des colonies durables sur les côtes méridionales de l’île, bien avant que les Inuits n’atteignent ces latitudes. Cette succession de peuplements violents, de disparitions et de remplacements rappelle que le Groenland n’est pas un sanctuaire anthropologique figé, mais un espace de lutte, de survie et de domination depuis plus d’un millénaire.
Lorsque le Danemark prend officiellement possession du territoire au début du XVIIIe siècle, il ne fait que s’inscrire dans une longue chaîne de prises de contrôle successives. La colonisation danoise se pare d’un discours religieux et administratif, mais elle s’appuie sur une réalité déjà façonnée par la disparition des anciens et par l’installation d’une population venue d’ailleurs. Aujourd’hui, le Groenland a quitté l’Union européenne depuis plusieurs décennies, par crainte de perdre la maîtrise de ses ressources halieutiques, tout en demeurant un territoire relevant du Danemark, pilier de l’Union européenne et membre discipliné de l’Alliance atlantique.
Cette construction juridique fragile se trouve désormais mise à l’épreuve par la volonté américaine. Donald Trump ne dissimule rien de son intérêt pour l’île. Il invoque la sécurité, la présence russe et chinoise dans l’Arctique, la nécessité de protéger le continent nord-américain. L’argument est commode. Depuis les accords de défense du milieu du XXe siècle, les États-Unis disposent déjà au Groenland d’un accès militaire quasi total, bases, radars, liberté d’installation. Aucune menace réelle ne justifie une annexion. Ce qui se joue est d’une autre nature, une logique d’appropriation territoriale, héritée d’un imaginaire impérial que l’Amérique contemporaine croyait avoir dépassé.
Face à cette pression, les Européens découvrent une situation que personne n’avait véritablement envisagée. Un territoire relevant d’un État membre central de l’Union européenne et de l’Otan se retrouve menacé par la première puissance de cette même alliance. Le cadre mental atlantique se fissure. Paris, Berlin et Londres évaluent désormais des scénarios autrefois impensables, non par goût de la confrontation, mais parce que l’inaction créerait un précédent impossible à contenir.
En France, la réflexion militaire s’est accélérée autour des capacités de projection en milieu polaire. L’expérience des opérations extérieures, la maîtrise des environnements contraints, la crédibilité navale (les sous-marins nucléaires d’attaque pèsent ici leur poids d’or) confèrent à Paris une marge de manœuvre réelle. En Allemagne, la prise de conscience est plus tardive mais profonde. Berlin comprend que l’effacement militaire n’est plus tenable dès lors que le territoire européen lui-même devient un objet de convoitise. Le Royaume-Uni, malgré sa sortie de l’Union, se sait directement concerné, car toute remise en cause des équilibres arctiques fragilise l’ensemble de l’Atlantique Nord et, à terme, ses propres possessions et routes maritimes.
Si l’Europe laissait faire, si elle acceptait qu’un fait accompli américain s’impose au Groenland, elle se condamnerait à une incohérence stratégique définitive. Comment prétendre s’opposer demain à d’autres annexions, à d’autres coups de force, si l’on admet aujourd’hui que le plus fort peut redessiner les cartes à sa guise ? Le monde n’obéit pas aux discours, il obéit aux précédents.
Il n’existe pas de solution miraculeuse pour écarter à jamais une prise de possession par la force. Une option demeure pourtant à portée des Européens, prendre les Américains au mot et affirmer concrètement une capacité de défense du territoire. Une présence militaire européenne crédible, unités arctiques, défense aérienne, moyens navals et aériens, transformerait immédiatement l’équation. Une intervention américaine resterait possible, mais elle deviendrait coûteuse, politiquement explosive, et humainement lourde.
Un tel geste offrirait à l’Europe un bénéfice inattendu. Il fournirait le choc psychologique nécessaire pour refonder la relation transatlantique. L’Atlantisme, ce monstre politique né de la défaite en 1945 des puissances continentales européennes, ne survivrait pas intact à une telle épreuve. Carl Schmitt rappelait que tout ordre politique repose, tôt ou tard, sur la désignation claire de l’ami et de l’ennemi. Le Groenland oblige l’Europe à sortir de l’ambiguïté.
Si les États-Unis attaquent et que l’Europe défend, l’équilibre du monde sera modifié. S’ils renoncent face à une présence européenne déterminée, un autre équilibre, plus mental que matériel, se sera imposé. Dans les deux cas, l’Europe cessera d’être un espace administré. Sur le quai du Guilvinec, tandis que les chalutiers disparaissent dans la brume du matin, il devient difficile de nier que la mer, une fois encore, nous intime de choisir entre la soumission tranquille et la responsabilité du large.
Source Breizh info cliquez ici
14:42 Publié dans Balbino Katz, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
mardi, 13 janvier 2026
De l’illusion institutionnelle à la violence nue, ce que dit la mort d’Alain Orsoni
Balbino Katz
Chroniqueur des vents et des marées
Il est des morts qui ne se contentent pas de clore une existence et qui ouvrent, par la manière même dont elles surviennent, un chapitre plus vaste, plus sombre, plus révélateur. La disparition de Alain Orsoni appartient à cette catégorie rare et funeste. Abattu d’un tir à longue distance, en plein cimetière, alors qu’il assistait aux obsèques de sa mère, l’homme emporte avec lui une part de l’histoire corse contemporaine et laisse derrière lui une île contrainte de se regarder sans fard, sans les voiles commodes de l’indignation médiatique.
J’observe cela depuis la Bretagne, avec ce regard d’étranger durable, enraciné sans être indigène, familier sans être du sérail. J’ai des ancêtres corses issus de l’Île-Rousse, mais je ne suis allé dans cette île qu’une seule fois dans ma vie, mû par une curiosité presque intellectuelle, celle de comprendre ce que l’on nomme aujourd’hui le mouvement palatin. Je connais peu la Corse par le corps, mais suffisamment par l’esprit pour discerner ce qu’elle tolère encore, ce qu’elle accepte par lassitude, et ce qu’elle rejette obstinément. Ce que j’y vois désormais, c’est moins un conservatoire de traditions figées qu’un laboratoire politique et humain, souvent en avance sur un continent qui se croit moderne alors qu’il n’est bien souvent que fatigué.
Ce qui s’est produit à Vero ne relève ni de la vendetta ancienne ni même du règlement de comptes ordinaire. On n’avait jamais tué en Corse lors d’obsèques. Pas même aux heures les plus sombres des haines claniques. Le lieu, le moment, la précision du geste introduisent une rupture. Ils disent que quelque chose s’est déplacé, ou peut-être effondré. Tirer à longue distance, en plein jour, lors d’une cérémonie funéraire, suppose des compétences presque militaires, une logistique, un sang-froid qui excluent l’acte isolé. Ce geste ne parle pas le langage politique, il parle celui d’un monde où l’efficacité prime sur le symbole, où l’intimidation devient démonstration de puissance.
La trajectoire d’Alain Orsoni ne se laisse pas enfermer dans une seule catégorie. Fils d’un militant de l’Algérie française, il appartient à cette génération façonnée par les débris encore chauds de l’empire, par le ressentiment, par une certaine idée de l’honneur et de la fidélité. Il passe par le GUD, ce creuset brutal et idéologique où se sont forgés nombre de nationalistes français des années soixante-dix, avant que l’affaire d’Aléria ne l’arrime définitivement à la cause corse. Le nationalisme, chez lui, n’est pas un vernis. C’est une conversion, presque une religion de substitution, avec ses dogmes, ses fidélités, ses aveuglements.
Ceux qui l’ont connu parlent d’un homme hors cadre, d’une intelligence redoutable, d’un tempérament qui refusait les demi-teintes. Pascal Gannat, père de Jean-Eudes, l’a rappelé avec une sobriété douloureuse, qui vaut témoignage plus que commentaire : « Triste nouvelle. La Corse est devenue un pays de mafia. On n’a jamais assassiné en Corse lors d’obsèques, même dans les pires vendetta. J’avais croisé assez régulièrement Alain Orsoni dans ma prime jeunesse, avec et chez des amis communs à Paris. C’était déjà une personnalité hors du cadre social habituel. Plutôt un idéaliste que la vie a happé vers une forme de désespoir. » Cette phrase éclaire autant l’homme que son destin. Orsoni n’était pas un cynique. Il était de ceux que l’Histoire utilise, puis abandonne.
Son parcours épouse les métamorphoses du nationalisme corse. Le temps du FLNC, des clandestinités structurées, des hiérarchies internes, puis celui du Mouvement pour l’autodétermination, plus politique, plus exposé, plus vulnérable aussi. À mesure que le nationalisme entrait dans les institutions, qu’il gagnait les exécutifs régionaux, il perdait ce qui faisait sa raison d’être. La conquête du pouvoir n’a débouché sur aucune refondation. Elle a accouché d’une gestion molle, souvent alignée sur les modes idéologiques du continent, jusqu’à accepter sans résistance la dilution démographique, culturelle et religieuse de l’île.
La mort d’Orsoni agit comme un tirage de rideau. Elle clôt un cycle né à Aléria et achevé dans les fauteuils feutrés de l’Assemblée de Corse. Elle révèle aussi la porosité entre certaines familles issues du nationalisme historique et les logiques du banditisme organisé. Beaucoup y voient la victoire définitive des logiques mafieuses. J’y vois plutôt un moment de vérité. La violence n’a pas disparu de Corse, elle a simplement changé de visage.
La stupeur des anciens, Jo Peraldi, Pierre Poggioli, la sidération de l’abbé Roger-Dominique Polge, leurs mots lourds, presque incrédules, disent l’effondrement des vieux codes. Le respect des morts, la sacralité des obsèques, ces lignes rouges que l’on croyait intangibles, ont été franchies. La vieille garde pleure un monde qu’elle sent s’éloigner, non sans une culpabilité diffuse, celle de n’avoir pas su empêcher la dérive.
Face à cette mort, un silence retient l’attention, celui de Nicolas Battini et de la Mossa Palatina. Aucun communiqué, aucune émotion affichée. Ce mutisme en dit long. Il marque une rupture nette avec le nationalisme des années quatre-vingt, celui des ambiguïtés, des compromis, parfois des compromissions. Les Palatins semblent tirer une ligne claire entre ce qu’ils estiment être un nationalisme à refonder et un passé jugé irrémédiablement vicié. Le silence devient ici un langage politique.
Il faut accepter une idée dérangeante pour l’esprit moderne. La Corse est une terre où la violence existe encore, et ce n’est pas forcément un mal absolu. Elle rappelle cette vérité trumpienne que tout n’est pas soluble dans la gestion, le droit mou, les indignations rituelles. Carl Schmitt notait que le politique commence avec la désignation de l’ennemi. Une société qui ne connaît plus aucune forme de violence symbolique ou réelle devient un espace ouvert à toutes les prédations. La violence, lorsqu’elle n’est pas purement criminelle, rend des choses possibles. Elle fixe des limites. Elle oblige à choisir.
La mort d’Alain Orsoni ne réhabilite rien et ne justifie rien. Elle oblige à regarder en face la fin d’un monde et l’émergence d’un autre, plus dur, plus froid, peut-être plus cohérent. L’île poursuit son histoire, indifférente aux lamentations venues du continent. Ceux qui prétendent encore aimer la Corse devront accepter cette part sombre, non pour la célébrer, mais pour ne plus se mentir.
Source Breizh info cliquez ici
12:12 Publié dans Balbino Katz, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
dimanche, 11 janvier 2026
L’enjeu groenlandais et l’autonomie européenne
Balbino Katz
Chroniqueur des vents et des marées
Je me tiens sur le quai du port du Guilvinec. Le jour est blafard, le vent coupe la joue et les coques quittent l’abri avec cette résolution taciturne qui fait les marins bretons. Le froid, ce matin-là, a quelque chose d’orientant. Il pousse l’esprit vers le nord, vers cette île immense et presque vide qui revient dans les conversations des chancelleries, le Groenland. Les mains dans les poches, je pense à cette possession danoise lointaine, entrée dans l’orbite de Copenhague au début du XVIIIᵉ siècle, en 1721, quand le royaume scandinave entreprit d’y rétablir une présence durable. Longtemps marginale, cette terre arctique est aujourd’hui scrutée avec une intensité nouvelle par les États-Unis.
Nouvelle dans sa forme, ancienne dans son fond. L’intérêt américain pour le Groenland n’est ni improvisé ni capricieux. Il traverse les décennies, des tentatives d’achat du XIXᵉ siècle aux accords de défense conclus pendant la Seconde Guerre mondiale, puis à l’installation de la base de Thulé, devenue aujourd’hui Pituffik, clef de voûte du dispositif antimissile nord-américain. Ce qui frappe désormais, c’est la verbalité assumée, la publicité donnée à cet intérêt par un président des États-Unis qui parle d’annexion, de nécessité stratégique, et le fait sans détour. La parole précède parfois l’acte, parfois elle le prépare.
Il suffit d’avoir la mémoire un peu longue pour se souvenir que Washington ne découvre pas aujourd’hui le goût des possessions ultramarines européennes. En 1898, profitant d’un prétexte fragile et d’une insurrection cubaine qu’ils soutenaient en sous-main, les États-Unis entrèrent en guerre contre l’Espagne. L’issue fut rapide. Cuba passa sous tutelle, Porto Rico fut annexé, les Philippines arrachées à Madrid. L’Europe observa, choquée sans doute, mais déjà résignée. L’Espagne, elle, encaissa le coup et produisit, dans la douleur, cette « génération de 98 » qui sut transformer la défaite en examen de conscience national.
L’histoire enseigne aussi l’art de l’oubli. Une fois le choc passé, le monde s’adapte. La puissance américaine est telle qu’on ne peut faire comme si elle n’existait pas, ni demeurer éternellement dans le ressentiment. En 1898, nombre de capitales européennes, Londres comprise, se félicitaient en silence de voir une puissance sœur, anglo-saxonne, prendre le relais d’un empire latin à bout de souffle. L’illusion d’une anglosphère harmonieuse faisait alors florès. Aujourd’hui, le décor a changé. Une prise de contrôle du Groenland sans l’accord de Copenhague poserait une question d’une autre nature, car elle viserait un allié, membre de l’OTAN, et mettrait à nu les lignes de fracture du continent.
Les scénarios circulent à voix basse. Action militaire rapide, pression politique locale, instrumentalisation du désir d’indépendance groenlandais, rien n’est exclu dans les hypothèses des diplomates. L’Europe, dans tous les cas, encaisserait un choc comparable à celui de l’Espagne finissante. Un choc peut-être salutaire. Le Groenland, à dire vrai, reste périphérique aux intérêts centraux européens, comme Saint-Pierre-et-Miquelon l’est pour la France. Sa perte ne bouleverserait pas l’équilibre géostratégique du Vieux Continent. En revanche, l’onde psychologique serait considérable. Elle poserait frontalement la question de l’alliance atlantique et de sa pertinence hors du cadre qui l’a justifiée, celui de la menace soviétique.
Ce moment pourrait donc être décisif. Non par la perte d’un territoire, fût-il immense, glacé et chargé de symboles, mais par la révélation brutale d’un malentendu ancien. L’Europe vit encore sur l’idée que l’alliance atlantique est un destin, alors qu’elle n’a jamais été qu’une conjoncture. La disparition de l’Union soviétique aurait dû entraîner sa dissolution naturelle ou, à tout le moins, sa transformation profonde. Rien de tel ne s’est produit. Par inertie, par confort, par peur aussi, les Européens ont prolongé un lien dont les termes se sont inversés. Le Groenland agit ici comme un révélateur chimique, faisant apparaître à la surface ce qui, jusque-là, restait dissous dans le langage diplomatique.
Cette fenêtre d’opportunité est étroite, et peut-être unique. Elle tient à la conjonction de plusieurs facteurs rarement réunis. Les États-Unis regardent désormais vers le Pacifique, vers la Chine, et considèrent l’Europe moins comme une alliée que comme un théâtre secondaire, utile tant qu’il ne contrarie pas leurs priorités. L’Europe, elle, dispose encore d’une puissance économique, technologique et démographique suffisante pour s’ériger en pôle autonome, à condition de le vouloir. Or la volonté politique naît rarement dans le confort. Elle surgit presque toujours d’un choc.
Sur ce point, les analyses de Mary Kaldor, pourtant éloignées de toute tentation continentale, méritent d’être relues. Dès les années 1990, elle soulignait que la communauté d’intérêts entre l’Amérique et l’Europe n’était ni naturelle ni éternelle, et que la divergence stratégique finirait par produire une rupture, non par hostilité idéologique, mais par simple logique de puissance. L’Amérique, écrivait-elle en substance, ne peut accepter durablement un partenaire qui aspire à l’autonomie dès lors que cette autonomie contrarie ses propres impératifs de sécurité globale.
Les penseurs français n’ont pas dit autre chose, chacun à leur manière. Raymond Aron, lucide jusqu’à la sécheresse, rappelait que les alliances ne survivent pas à la disparition de la menace qui les a fondées. Pierre Hassner insistait sur la fragilité des solidarités occidentales dès lors qu’elles ne reposent plus sur un péril commun clairement identifié. Plus récemment, Marcel Gauchet a montré combien l’Europe s’était enfermée dans une posture post-historique, croyant pouvoir substituer le droit, les normes et les procédures à la décision politique, oubliant que celles-ci ne valent que si elles sont adossées à une force capable de les défendre.
L’éventuelle prise de contrôle du Groenland par les États-Unis serait alors moins un drame territorial qu’un événement fondateur. Un rappel brutal que la souveraineté ne se délègue pas indéfiniment, que la protection a toujours un prix, et que l’Histoire ne s’arrête jamais, même sous la banquise. L’Europe serait placée devant une alternative simple, presque brutale, continuer à vivre dans l’ombre stratégique d’une puissance extra-européenne, ou accepter le risque, donc la responsabilité, de son indépendance.
Sur le quai du Guilvinec, le froid finit par engourdir les doigts. Les marins, eux, savent qu’il faut parfois sortir malgré la mer mauvaise, faute de quoi on meurt à quai. Le Groenland pourrait être cette mer mauvaise. Une épreuve rude, inconfortable, mais peut-être nécessaire pour qu’un continent cesse enfin de confondre sécurité et dépendance, et retrouve le goût âpre de la décision.
Source Breizh Info cliquez ici
11:59 Publié dans Balbino Katz, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
samedi, 10 janvier 2026
Cartographie de l’insécurité et de l’immigratiion en France

Une application en ligne fait actuellement trembler une partie de la classe politique française. Son nom : mafrance.app, relayée sur X par le compte « Où va ma France ? ». Son principe est simple, mais explosif : compiler des données publiques pour dresser une cartographie précise de l’évolution sociale du pays. Résultat : une lecture brute, chiffrée, parfois glaçante de la transformation de nombreux territoires.
Lire la suite ICI
Source : breizh.info
08:40 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
vendredi, 09 janvier 2026
Mercosur, l’Europe sans la France

Vincent Trémolet de Villers
C’est l’histoire d’un pouvoir qui a perdu le pouvoir. Il a commencé par déléguer sa souveraineté aux instances européennes pour les questions commerciales et agricoles ; il a soutenu à demi-mot un traité de libre-échange qu’il refuse aujourd’hui avec toute l’éloquence des démagogies de circonstance ; il a menti à Bruxelles, il a menti aux agriculteurs, il a menti aux électeurs, il s’est menti à lui-même : il se trouve emporté dans le siphon de ses mensonges.
Le traité du Mercosur n’est plus un texte commercial, c’est devenu un symbole politique qui, malgré lui, cristallise des années de renoncements, de confusions, de court-termisme, de double discours. Le génie européen de l’embrouille bureaucratique ; l’art français de la défaite.
Côté Bruxelles, c’est une figure très contestée, celle d’Ursula von der Leyen, qui va se charger de la signature finale. À son passif, la destruction méthodique de l’industrie automobile ; la décroissance énergétique, avec, pendant trop longtemps, une hostilité sourde au nucléaire ; la névrose normative sous couvert d’écologie (le « Green Deal ») ; les carcans de vigilance, de transparence, de précautions qui entravent nos entreprises : le politiquement correct en guise de politique. Elle essaye de faire marche arrière mais c’est trop tard ; pour les agriculteurs, VDL, c’est l’acronyme d’une Europe hors sol et hostile.
Côté Paris, Emmanuel Macron est pris au piège. Entre suivre l’Europe et exaspérer la France ou défendre la France sans que cette opposition empêche l’adoption du traité, il a choisi la seconde solution. Dans les circonstances, c’est la moins mauvaise, mais elle s’accompagne d’une humiliation cruelle : le chantre de la souveraineté européenne voit le pays dont il a la charge contraint de se soumettre au choix antagonique d’une majorité qualifiée.
En attendant, les éleveurs et les Centaure de la gendarmerie se livrent à un face-à-face qui serre le cœur. Des gens qui travaillent dur, qui nourrissent le pays et que l’on arrose de subventions en espérant qu’ils accepteront de disparaître en silence. Ce mépris des sachants (qui se trompent énormément) décuple la colère. Pouvoir faible, intraitable avec ceux qui le sont plus encore.
Source : Le Figaro 9 /01/2026
13:09 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
jeudi, 08 janvier 2026
La candidature de Sarah Knafo à la Mairie de Paris est un événement majeur
Editorial de Cyrano sur Riposte laïque de ce matin cliquez ici
Décidément, Sarah Knafo ne passe pas inaperçue en ce début d’année 2026. Déjà révélation politique de l’année 2025, elle a été celle qui a été le plus loin, parmi les dirigeants français, dans ce qui apparaît comme un soutien inconditionnel à Donald Trump, lors de l’opération menée au Venezuela. Une position qui d’ailleurs occasionne des débats internes animés, au sein de la rédaction de Riposte Laïque, où certains contributeurs font part de leur déception devant une telle position, quand d’autres soutiennent la ligne de Reconquête sur ce dossier. À noter que les échanges sont de qualité, respectueux de l’autre, et que notre site donne ainsi à nos lecteurs la possibilité de se faire eux-mêmes une opinion. Certains fustigent ce qu’ils appellent l’impérialisme américain, quand d’autres ont choisi le camp de Donald Trump contre le communisme, dans la guerre qui s’annonce avec la Chine.
Depuis plusieurs mois, Sarah Knafo avait fait savoir son intérêt pour la mairie de Paris, mais annonçait réfléchir avant de prendre sa décision. Elle l’a annoncée en direct au journal de 20 heures de TF1, profitant d’une belle promotion offerte par la renommée de TF1.
Certains diront que la candidature de la numéro 2 de Reconquête, parti crédité d’à peine 5 % dans les sondages, à la mairie de Paris, est un non-événement. Ils se trompent, car Sarah Knafo a une particularité que n’a aucun autre responsable politique : c’est une surdouée promise à un grand avenir. Sa jeunesse n’est absolument pas un handicap, tant elle maîtrise les dossiers qu’elle traite. C’est sans doute la meilleure porte-parole du camp patriote. C’est une travailleuse exceptionnelle, qui, à chacune de ses interventions, marque les esprits. Ce n’est pas pour rien que les militants l’adorent et que certains se prennent à rêver de sa candidature pour la présidentielle de 2027, hypothèse qu’elle a repoussée ce soir, sur TF1.
Bien évidemment, la machine de guerre Sarah Knafo va se mettre en place, et elle va annoncer, sur la fiscalité et l’insécurité, des mesures-chocs qui vont changer les priorités de la campagne. Comme Éric Zemmour en 2022, sur l’immigration, avant l’intervention de Poutine en Ukraine, c’est elle qui va fixer les thèmes aux autres candidats, qui vont lui courir après. Il suffit de regarder le site, déjà prêt, « Sarah pour Paris », pour voir que tout a été pensé, et que tout est prêt pour une campagne percutante.
Sa candidature redistribue les cartes. Elle était déjà donnée à des scores impressionnants, avant de l’annoncer. Elle va cibler essentiellement la gauche, et on devine que, contrairement au RN, enlisé dans son « Ni gauche ni droite », elle n’hésitera pas à aider Rachida Dati, au deuxième tour, pour débarrasser définitivement la capitale de la clique Hidalgo, des socialauds, des écolos, des cocos et de tous les nuisibles qui pourrissent la vie des Parisiens et des banlieusards depuis trop longtemps.
On va vivre une campagne parisienne des plus passionnantes, avec en outre la présence de Sophia Chikirou, qui ne rêve que d’une chose : tailler des croupières aux socialistes et arriver devant eux, pour les humilier dans une alliance qu’ils disent refuser… pour l’instant.
Enfin, Thierry Mariani, le candidat du RN, malgré ses qualités, va souffrir de la présence de Sarah, et il aura du mal, entre les deux tours, à justifier une abstention qui risque de profiter à la gauche.
Tout paraît se mettre en place pour un axe Dati-Knafo au deuxième tour, capable de prendre la mairie. Reste à savoir dans quel ordre…
Pour consulter le site "Sarah pour Paris" cliquez ici
13:17 Publié dans Municipales 2026, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
mercredi, 07 janvier 2026
Après le grand basculement

Le coup de force de Caracas confirme le retour des empires dans un monde où la France et l’Europe sont faibles. Une fois de plus, Pierre Lellouche nous livre une analyse géopolitique pertinente de ce qu’induit la politique de Donald Trump. Une fois encore, les Américains sèment le désordre. Mais ils ont accouché cette fois du retour des empires, Russie, Chine, Inde qui viennent contester son hégémonie. Face à ce chaos, les Européens, faute d’entente, sont totalement démunis. Où va-t-on ?
Lire la suite ICI
Source : Valeurs actuelles 7/1/2026
07:42 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
Rumeurs d’effondrement du régime iranien : l’hypothèse d’une restauration royale
Etienne Lombard
Boulevard Voltaire, cliquez ici
Alors que le pouvoir semble vaciller, les slogans pro-Pahlavi se font entendre dans les rues de Téhéran.
La capture de Nicolás Maduro par les États-Unis va-t-il déclencher une réaction en chaîne, dont le régime islamiste iranien serait la première victime ?
Un pouvoir de plus en plus fragile
Si l’incapacité de ce dernier à faire face aux graves difficultés économiques auxquelles il est confronté a fourni à ses opposants un prétexte supplémentaire pour profiter d’une grève des commerçants d'un bazar de Téhéran pour descendre dans les rues, réduire les récentes manifestations à une simple protestation « contre la vie chère », comme l’ont fait de nombreux médias français, n’est guère sérieux. L’accentuation des tensions dans le pays suffit d’ailleurs à montrer que les Iraniens ne réclament pas tant des « soldes » que la fin du régime des mollahs. Après deux soulèvements importants en 2019 et 2022, le pouvoir iranien avait engagé un bras de fer armé avec Israël, lequel avait alors fini par décider Washington à intervenir pour bombarder et détruire en grande partie les sites nucléaires iraniens. Téhéran perdait ensuite, coup sur coup, ses deux alliés au Proche-Orient : le Hamas, neutralisé pour un temps au moins à Gaza, et le Hezbollah, écrasé par les Israéliens au Liban. Autant de secousses, sur les fronts intérieurs et extérieurs, qui ont fragilisé les positions du pouvoir iranien et enhardi ses oppositions.
Le régime en mode « survie »
Depuis une semaine, de nouvelles manifestations ont eu lieu, occasionnant des affrontements qui auraient fait entre 12 et 16 morts à Téhéran et dans quelques autres villes, selon l’AFP, mais Iran International, média qui serait proche de l’Arabie saoudite, avance de son côté un bilan de 20 morts et des troubles dans plus de 220 localités. Le pouvoir iranien semble par ailleurs divisé sur la conduite à tenir face aux émeutiers. Si le président Masoud Pezeshkian a admis n’avoir « aucune idée » pour résoudre la crise en cours et dit faire la distinction entre les appels au soulèvement et des revendications économiques « légitimes », le Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, s’est montré beaucoup moins conciliant : « Les manifestants doivent être remis à leur place », a-t-il déclaré, accusant des forces étrangères d’avoir provoqué un effondrement du cours du rial. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Aragchi, évoquant la situation du pays devant la presse, a quant à lui parlé de « lutte pour la survie du régime ».
À Londres, on voit Khamenei bientôt à Moscou
Et pour ajouter à la confusion générale, après la capture de Nicolás Maduro par les Américains et la menace d’intervention adressée par Donald Trump au pouvoir iranien si ce dernier tuait d’autres « manifestants pacifiques », les services de renseignement britanniques ont déclaré que l'ayatollah Ali Khamenei envisagerait de fuir en Russie. Une information à prendre évidemment avec prudence, mais pour le prince Davoud Pahlavi (cousin du prince héritier Reza Pahlavi), qui a accepté de répondre à BV, « à 86 ans, ce dernier disposerait d’un plan d’urgence pour fuir vers Moscou, accompagné d’un cercle restreint de proches, afin de rejoindre Bachar el-Assad en cas d’effondrement du régime. Ces informations, fondées sur des sources de renseignement, paraissent tout à fait plausibles et logiques. » La situation actuelle, qui pourrait évoluer très vite, fait évidemment penser à celle de 1979, qui avait vu la chute du régime impérial, mais « contrairement à 1979, où deux forces idéologiques structurées s’affrontaient et dominaient la scène », explique le prince Davoud Pahlavi, « les soulèvements récents révèlent une réalité bien différente : le changement, s’il doit advenir, naîtra probablement de la rue iranienne elle-même ».
Une « monarchie constitutionnelle, modernisée » ?
La révolution khomeiniste avait été brutale et sanglante, la contre-révolution pourrait-elle l’être aussi ? « Contrairement à ce que certains imaginent, le passage d’un régime autoritaire à une démocratie durable ne saurait s’accomplir dans le chaos ou par des ruptures brutales. Il nécessite au contraire une période de stabilité, un temps de respiration collective, afin de poser les fondations solides d’un avenir libre et apaisé », juge Davoud Pahlavi. « C’est précisément pourquoi je considère qu’un gouvernement de transition, représente la voie la plus sage », plaide le prince, pour qui « une telle instance aurait pour mission essentielle de garantir la sécurité du pays, de restaurer l’ordre public sans répression, de protéger les institutions vitales et, surtout, de préparer le terrain pour des élections libres et transparentes. » De même considère-t-il que le retour des Pahlavi ne constituerait pas une restauration pure et simple de « l’ancien régime » : « Il est temps de réinventer notre monarchie, de l’adapter aux exigences de l’ère contemporaine, en puisant avec sagesse dans les meilleures pratiques des autres monarchies du globe, tout en préservant jalousement notre identité iranienne et notre riche héritage culturel. » Partisan d’une « monarchie constitutionnelle, dans sa forme modernisée », le prince confirme qu’il se tiendrait à disposition de son cousin si celui-ci faisait appel à lui.
Reste à savoir si le régime des mollahs tombera. Si oui, quand il tombera. Et si l’Iran choisirait, alors, la voie républicaine ou une nouvelle voie royale.
00:51 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
lundi, 05 janvier 2026
Destitution-arrestation du tyran rouge Maduro au Venezuela : un éclairage bienvenu de Vincent Hervouet, sur Europe 1, dans la matinale animée par Dimitri Pavlenko

C’est simple la géopolitique finalement, Vincent, puisqu’à la veille de Noël vous nous aviez dit que Donald Trump irait jusqu’au bout. Nicolas Maduro serait débarqué manu militari après avoir été trahi par son entourage, et c’est donc bien ce qui s’est passé.
Alors, on aurait même pu prévoir le jour puisque le 3 janvier, la Maison Blanche s’offre des étrennes. C’est la bonne date pour passer à l’attaque et décapiter les régimes honnis. En 2020, le 3 janvier, Donald Trump s’était payé le scalp du général Soleimani, le vrai numéro 2 iranien, exécuté par un tir de missile. En 1990, le 3 janvier, il y a surtout le précédent panaméen que tous les Latino-Américains connaissent. Manuel Noriega, (…) réfugié à la nonciature apostolique, à Panama Ciudad, se rendait au corps expéditionnaire américain qui lui faisait subir de la musique hard rock, depuis une quinzaine de jours, à plein tube, jour et nuit. Il a été jugé aux États-Unis pour trafic de drogue. C’est le sort promis à Maduro. Noriega a passé les vingt ans qui ont suivi dans une prison américaine, sauf un détour par la prison de la Santé, à Paris, car il avait été condamné pour blanchiment alors qu’il se croyait à l’abri, François Mitterrand l’ayant élevé, juste avant, au grade de commandeur de la Légion d’honneur. Parfois, la France s’égare…
Justement, Emmanuel Macron est critiqué pour ne pas avoir dénoncé l’enlèvement de Maduro comme une atteinte au droit international et à la souveraineté des nations.
Écoutez, Emmanuel Macron a d’autres priorités que de faire la leçon à la Maison Blanche sur leurs opérations de police. Il laisse les mains libres aux Américains de faire ce qu’ils veulent aux Amériques pour leur réclamer la pareille ; c’est-à-dire qu’ils prennent en compte ce que les Européens veulent dans leur propre arrière-cour, (…) en Ukraine. J’ajoute qu’Emmanuel Macron avait tenté, il y a trois ans, une diplomatie acrobatique au Venezuela. La France avait reconnu l’opposant Guaidos comme le président légitime, mais elle parlait en même temps avec Maduro resté au pouvoir et elle tentait une médiation qui a tourné en quenouille. L’Élysée disait à l’époque que le dialogue était la seule issue à la crise au Venezuela. Donald Trump a montré ce week-end qu’il y avait mieux à faire que de parler pour ne rien faire : faire la paix par la force.
La figure la plus connue de l’opposition vénézuélienne, c’est la prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, mais alors, Donald Trump la dénigre.
Et pourtant, elle lui avait dédié son prix Nobel, mais le Donald prétend qu’elle n’a aucune autorité dans le pays. C’est presque ce que disait d’elle Hugo Chavez, et c’est assez faux. Au Venezuela, on la surnomme, comme Bolivar, la Libertadora. Ce qu’il faut comprendre, c’est que Donald Trump fait le contraire de ses prédécesseurs. Il ne veut pas exporter la démocratie libérale, il se fiche de la corruption, du népotisme, des inégalités criantes qui sont chroniques au Venezuela. Il ne se préoccupe que des intérêts américains, c’est-à-dire que la Chine, les gardiens de la Révolution, les narcos colombiens, les Russes débarrassent le plancher, que les pétroliers américains récupèrent les biens dont ils ont été spoliés, que l’intérêt stratégiques que constituent les réserves pétrolières les plus importantes au monde soient entre de bonnes mains ; et pour le reste, comme d’habitude, l’Amérique jouera avec les potentats locaux comme un enfant joue avec des cubes. Le président adoubé par l’armée, la présidente, Delcy Rodriguez, est l’incarnation de la bourgeoisie rouge. Selon Donald Trump, elle est prête à coopérer. En fait, c’est une femme qui est prête à tout. Depuis 25 ans, elle gravite au sommet : ministre, présidente de l’Assemblée nationale constituante, vice-présidente. En novembre, (une agence) révélait qu’elle négociait l’échange de Maduro contre la survie du régime. C’est ce qui s’est passé, semble-t-il. L’armée, en tout cas, est restée l’arme au pied et elle tient toujours le pays.
11:39 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
vendredi, 02 janvier 2026
Misère de la politique, espoir pour la France

Le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézet, dresse un bilan lucide sur l’état de notre pays littéralement anéantit par une classe politique irresponsable. Du Parlement, on ne comprend plus rien tant les compromissions surréalistes n’arrangent personne au final mais soulignent les reniements, une économie en berne dans le genre jamais vue depuis la Libération, et une France qui sombre dans l’insécurité, une immigration pas contrôlée et bouquet final, une France fractionnée entre riches, immigrés et Gaulois – Français de souche -, qui ne se reconnaissent plus dans les choix civilisationnels qu’on lui impose. Dire que l’on est au bord du gouffre est un euphémisme.
Lire la suite ICI
Source : Le Figaro 02/01/2026
12:04 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
mercredi, 31 décembre 2025
L’autre Bardot : derrière la beauté, la défense de l’identité française
Claude Lorne, Polémia cliquez ici
Le fabuleux parcours de Brigitte Bardot peut paraître surprenant. Il ne l’est pas. Il a un fil rouge : elle est toujours à l’avant-garde. À l’avant-garde de la libération de la femme dans les années 1950/1960 avec « Et Dieu créa la femme ». À l’avant-garde du mouvement animaliste dans les années 1970 lors de la création de la fondation Bardot. À l’avant-garde de la défense de la civilisation européenne dans les années 1990 dans sa critique de l’islam. Religion profondément contraire — voile islamique, abattage halal, entre autres — à ses combats antérieurs. Toute sa vie, BB fut une rebelle incarnant l’esprit et l’élégance française.
Polémia
Avec Greta Garbo, Brigitte Bardot, décédée nonagénaire le 28 décembre, était la seule star internationale qui, après s’être retirée en pleine gloire depuis des décennies, continuait de passionner le public et gardait son aura. Sans doute grâce à sa passion pour la cause animale, mais aussi pour ses positions politiques comme éthiques, de moins en moins consensuelles à mesure que le temps passait et que s’enlaidissait la nouvelle France.
Ainsi, toute jeune vedette, elle avait tenu, en 1959, accompagnée du lieutenant de Légion Le Pen (avec lequel elle devait garder jusqu’au bout une solide amitié) et du député d’Alger Pierre Lagaillarde, à aller réconforter à l’hôpital militaire de cette ville les soldats blessés en opérations contre le FLN. De même, dès la naissance, en 1986, de la Fondation portant son nom (et qu’elle avait lancée et financée à concurrence de 3 millions de francs par la vente de ses objets de valeur, dont « l’immense diamant » offert par son troisième mari, Gunther Sachs), avait-elle choisi comme directrice nationale Liliane Sujansky, épouse d’un rescapé de l’insurrection de Budapest (automne 1956), président des Hongrois en exil et anticommuniste revendiqué.
BB contre le MLF…
Pour des millions de Françaises, B.B., issue de la haute bourgeoisie parisienne, avait incarné, à la faveur de son film Et Dieu… créa la femme, la libération de la gent féminine. Une libération essentiellement sexuelle, qu’elle devait juger ensuite plutôt frelatée, comme la posture anti-OAS qu’elle avait adoptée ensuite sous l’emprise des Sami Frey et autres Serge Gainsbourg avec lesquels elle s’était commise. Dès 1973, elle déclare en effet au sujet du MLF : « Jamais les femmes ne seront comme des hommes. Si elles sont si malheureuses, c’est qu’elles ne veulent plus être ce qu’elles sont. Ne plus être l’“objet”. Mais revendiquer des droits propres aux femmes comme le fait le MLF, c’est parfaitement comique et idiot… Pour se réaliser pleinement, les femmes doivent rester des femmes. Et les vraies femmes, il n’y en a plus. Les vrais hommes non plus. On constate en ce moment une mutation d’un sexe à l’autre. Les hommes sont des minets et les femmes essaient d’être des hommes. » Ça ne s’est pas arrangé depuis…
Brigitte Bardot, gauloise sans filtre
Même liberté de ton quand elle soutient le mouvement des Gilets jaunes en 2018, puis, en 2020, la police qui « nous protège de la racaille envahissante ».
En 1999, elle avait déjà admis partager « certaines idées du FN, notamment contre la forte immigration en France », immigration qui aura importé à grande échelle la pratique de l’abattage halal, contre lequel l’ancienne actrice aura lutté jusqu’au bout, au risque de procès.
Poursuivie par la LICRA, le MRAP et la Ligue des droits de l’homme, la recluse de La Madrague fut ainsi lourdement condamnée en 1997 pour incitation à la haine après avoir déclaré au Figaro : « Voilà que mon pays, la France, ma patrie, ma terre, est de nouveau envahie, avec la bénédiction de nos gouvernements successifs, par une surpopulation étrangère, notamment musulmane, à laquelle nous faisons allégeance. De ce débordement islamique, nous devons subir, à nos corps défendants, toutes les traditions. D’année en année, nous voyons fleurir les mosquées un peu partout en France alors que nos clochers d’églises se taisent faute de curés. […] Serai-je obligée de fuir mon pays devenu terre sanglante pour m’expatrier ? ».
Nouveau procès quand, dans son livre Un cri dans le silence (2003), elle se dit carrément « contre l’islamisation de la France » : « Cette allégeance obligatoire et cette soumission forcée me dégoûtent… Nos aïeux, les anciens, nos grands-pères, nos pères ont donné leur vie depuis des siècles pour chasser de France tous les envahisseurs successifs. Pour faire de notre pays une patrie libre qui n’ait pas à subir le joug d’aucun étranger. Or, depuis une vingtaine d’années, nous nous soumettons à une infiltration souterraine et dangereuse, non contrôlée, qui, non seulement ne se plie pas à nos lois et coutumes, mais encore, au fil des ans, tente de nous imposer les siennes. »
Même rejet du métissage : « Alors que chez les animaux, la race atteint des sommets de vigilance extrême, les bâtards étant considérés comme des résidus, bons à laisser pourrir dans les fourrières, ou à crever sans compassion d’aucune sorte, nous voilà réduits à tirer une fierté politiquement correcte à nous mélanger, à brasser nos gènes, à faire allégeance de nos souches afin de laisser croiser à jamais nos descendances par des prédominances laïques ou religieuses fanatiquement issues de nos antagonismes les plus viscéraux. C’est extrêmement dommage. »
Autant de propos qui, post mortem, ont valu à la « pasionaria de la cause animale » d’être caricaturée par les maîtres-censeurs de Libération en « figure d’une droite identitaire qu’elle nourrissait de diatribes xénophobes et d’attaques contre l’islam », au point de « dériver vers la haine raciale ».
Cette « ravissante idiote » (titre d’un film de 1964 qui ne laissait rien ignorer de la parfaite plastique de B.B.) apparaît avec le recul infiniment plus consciente des réalités présentes que nos kyrielles de présidents, de ministres et d’intellos.
13:02 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
Europe : renouer le lien entre nations, puissance et destin commun

Yann Vallerie
Depuis des décennies, le projet européen avance sur une ligne de fracture mal assumée. D’un côté, une technocratie convaincue que l’avenir du continent passe par l’effacement progressif des nations – la France républicaine et universaliste ayant été parmi les premières à broyer les nations vivant en hexagone pour tenter de constituer une nation artificielle.
De l’autre, des peuples attachés à leurs langues, à leurs mémoires, à leurs territoires, qui perçoivent cette dynamique comme une dépossession. Ce malentendu structurel explique en grande partie l’essoufflement politique de l’Europe et l’hostilité croissante qu’elle suscite.
Les promoteurs d’une Europe abstraite, dignes fils de cette France dites « des lumières », ont fait de l’identité régionale, nationale un obstacle, un archaïsme à dépasser, voire une pathologie à corriger. À leurs yeux, l’attachement à une patrie, à une histoire particulière, à des traditions héritées, relèverait d’un réflexe irrationnel, incompatible avec un ordre continental fondé sur la seule rationalité économique et juridique. Cette vision, pourtant, se heurte au réel. Aucun ensemble politique durable ne peut se construire sans sentiment d’appartenance partagé. Et en Europe, ce sentiment passe d’abord par les nations.
À l’inverse, une partie des courants nationalistes se replient sur une logique défensive et fragmentée, refusant toute forme de construction commune au nom de la souveraineté, une souveraineté qu’ils refusent parfois pour les peuples qui vivent sur le même territoire (il suffit de voir le jacobinisme du RN vis à vis de nos régions, lui-même qui dénonce la perte de souveraineté au niveau européen). Cette posture ignore cependant un fait central : dans un monde dominé par des blocs continentaux, des puissances démographiques et des acteurs économiques globaux, le petit État européen isolé n’a plus les moyens de peser. Ni militairement, ni économiquement, ni culturellement. Ce refus de penser l’échelle européenne affaiblit précisément ce que ces courants prétendent défendre.
La contradiction n’est pourtant pas insoluble. Elle repose sur une erreur de perspective : croire que nation et Europe seraient par nature antagonistes. L’histoire démontre l’inverse. Le continent européen s’est construit comme un espace singulier où des peuples enracinés, dotés de fortes identités historiques, ont coexisté, se sont affrontés parfois, mais ont aussi forgé un socle civilisationnel commun. C’est cette pluralité structurée qui fait l’Europe, non son effacement.
L’identité européenne repose sur deux piliers indissociables. Le premier est l’enracinement : un territoire, une mémoire collective, une continuité historique, des ethnies proches. Sans cela, il n’y a pas de peuple, seulement des individus atomisés. Le second est l’idée de liberté civique : la volonté de vivre en citoyens responsables, au sein d’une communauté politique consciente d’elle-même. Sans ce second pilier, l’enracinement dégénère en domination ou en autoritarisme. Ensemble, ils ont permis l’émergence d’un modèle européen original.
C’est cette articulation qui a rendu possibles les grandes constructions sociales, politiques et culturelles du continent. Les nations ont servi de matrice à la démocratie, à la séparation du religieux et du politique, à l’idée d’égalité civique, à la solidarité collective. Chaque peuple de notre civilisation a contribué, à sa manière, à cet héritage commun. Les grands événements nationaux européens n’ont jamais été de simples épisodes locaux : ils ont irradié bien au-delà de leurs frontières.
Les révolutions, les résistances, les luttes pour la liberté, mais aussi les grandes défenses civilisationnelles face aux menaces extérieures, constituent une mémoire partagée. De l’Europe médiévale aux combats contemporains à ses frontières orientales, le continent s’est forgé dans l’épreuve. Ces moments ne dissolvent pas les nations ; ils les relient.
Il en va de même pour les traditions populaires, religieuses ou mythologiques, souvent moquées par les élites modernes. Elles forment pourtant un tissu symbolique commun, décliné selon les peuples, mais reposant sur des archétypes semblables : le rapport au sacré, aux saisons, au bien et au mal, à la communauté. L’Europe n’est pas une page blanche, mais une superposition de couches culturelles païennes, romaines et chrétiennes, encore vivantes.
Les inquiétudes actuelles des Européens ne sont pas des fantasmes. Elles traduisent un sentiment diffus de perte : insécurité, délitement des normes, effacement des repères culturels, affaiblissement de la parole libre, fragilisation démocratique. Ce malaise est souvent disqualifié comme intolérance, alors qu’il exprime avant tout la peur de voir disparaître un mode de vie patiemment construit.
En niant cette angoisse, en méprisant l’attachement aux nations, une partie du camp européiste s’est coupée des peuples. Pire, en promouvant une vision hyper-individualiste de l’identité, réduite à l’auto-définition subjective, elle a vidé le projet européen de toute substance collective. Une Europe qui refuse aux peuples le droit d’aimer ce qu’ils sont ne peut susciter ni loyauté ni engagement.
À l’inverse, une Europe conçue comme outil de protection des nations retrouve un sens politique. Protection des cultures, des traditions, des espaces publics, de la sécurité, de la souveraineté civilisationnelle. Dans plusieurs pays situés aux marges du continent, cette évidence est déjà acquise : l’Europe y est perçue comme un rempart permettant aux nations de survivre, non de disparaître.
Le défi n’est donc pas de dépasser les nations, mais de les articuler dans un cadre de puissance commune. Cela implique des compromis, des renoncements partiels, une vision stratégique à long terme. Mais le coût de l’inaction serait bien plus élevé. Dans un monde qui se réorganise brutalement, le continent ne peut se permettre ni la fragmentation, ni l’utopie désincarnée.
L’avenir de l’Europe, dépend de sa capacité à redevenir une maison commune pour des peuples libres, enracinés et conscients de leur destin partagé. Ce n’est qu’en assumant cette réalité que l’idée européenne pourra retrouver une force politique, affective et historique. Non contre les nations, mais par elles.
Source : Breizh.info
10:38 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
lundi, 29 décembre 2025
Génocide vendéen : l’histoire qu’on ne devait pas raconter
"les Français seront de plus en plus nombreux à mieux comprendre, à mieux estimer la résistance et le sacrifice de la Vendée." En 1993, Alexandre Soljenitsyne rend hommage aux martyrs vendéens aux Lucs-sur-Boulogne, aux cûtés de Philippe de Villiers et d'Alain Delon.
France Goutierre Valeurs actuelles cliquez ici
Il y a quarante ans, les guerres de Vendée ont donné lieu à un affrontement qui a valu, aux auteurs d’un récit dissident, une disqualification féroce. Relégués aux marges de l’histoire dominante, ces parias intellectuels o nt fini par imposer le débat. Récit d’une reconnaissance.
Pau, hiver 2024. Dans la discrétion d’un collège-lycée privé des Pyrénées-atlantiques, une conférence intitulée “Vendée, de la guerre civile au génocide, du génocide au mémoricide”, doit être animée par Reynald Secher, figure connue pour sa thèse du “génocide vendéen” durant la Révolution française. La FSU 64 (Fédération syndicale unitaire) dénonce publiquement une vision de l’histoire jugée « événementielle, dépassée, mêlant ethnocentrisme et religion », et s’inquiète de ce qui sera transmis aux lycéens en cours d’enseignement moral et civique et d’histoire-géographie.
L’épisode aurait pu s’arrêter là. Mais quelques semaines plus tard, le directeur de l’immaculée-conception reçoit, à sa grande surprise, une lettre de la rectrice de l’académie de Bordeaux, Anne Bisagni-faure. Elle y condamne explicitement « l’utilisation du terme de génocide dans un cours d’histoire sur la Révolution française » et l’organisation d’une conférence défendant, selon elle, une approche révisionniste. L’affaire aura de lourdes conséquences pour le chef d’établissement qui sera finalement remercié. En cause, ses supposées atteintes à la laïcité. Plus de deux siècles après les guerres de Vendée, cette page d’histoire demeure inflammable.
La République n’a jamais aimé se regarder dans le miroir vendéen
Pourtant, il n’est plus interdit d’en parler comme au moment du bicentenaire de 1789, lorsque les guerres de Vendée constituaient une véritable épine dans le pied d’une République triomphante et sûre de sa “glorieuse” Révolution. La grande commémoration voulue par François Mitterrand et Michel Rocard devait être un temps fort de consensus, une jubilation nationale célébrant l’avènement des droits de l’homme et de l’égalité devant la loi. Tout ce qui fissurait cet héritage — la guerre civile, la Terreur, la répression menée dans l’ouest par l’état révolutionnaire — était traité comme une scorie de l’histoire. La République n’a jamais aimé se regarder dans le miroir vendéen.
C’est dans ce contexte qu’émergent des ouvrages qui bouleversent l’historiographie officielle. En 1987, Carrier et la Terreur nantaise (Perrin), de JeanJoël Brégeon, aborde déjà la question d’une politique d’extermination dans l’ouest insurgé. La même année, Reynald Secher republie la Guerre de la Vendée et le système de dépopulation (Tallandier), avec Jean-joël Brégeon, un livre longtemps escamoté de Gracchus Babeuf qu’il a déniché aux archives. Ce libelle accusait Robespierre d’avoir orchestré la répression de la Vendée et mettait en circulation le terme de “populicide”, promis à une nouvelle fortune polémique.
Après sa monographie La Chapelle-Basse-mer, village vendéen (Perrin, 1986), Secher publie La Vendée-vengé (Puf, 1986). Le génocide franco-français, une thèse provocatrice qui prend le contre-pied d’une historiographie souvent tentée de minimiser ou de nier l’ampleur des massacres. Il y estime que 117.000 Vendéens auraient disparu après la Révolution, chiffre qui provoque un tollé immédiat, relayé jusque dans les médias grand public.
Les historiens de gauche, en ordre de bataille derrière le spécialiste marxiste de la Révolution française Jean-Clément Martin, rejettent le terme “génocide”, préférant “crimes de guerre” et les analysant comme de simples dérives. Secher, lui, forge le concept de “mémoricide”, un crime contre la mémoire des victimes. Le courant majoritaire n’a évidemment pas manqué de lui reprocher d’exacerber la mémoire et donc de ne pas faire oeuvre d’historien.
Pourtant, la lutte mémorielle est déjà loin derrière. Dans les premières décennies qui suivent la fin des guerres de
Le courant jacobin défend la Révolution en occultant sa violence, et le courant contre-révolutionnaire, souvent d’inspiration monarchiste, insiste sur l’ampleur de la répression et la spécificité de la Vendée.
Vendée, le conflit se transmet d’abord par la mémoire des acteurs eux-mêmes. Officiers républicains comme anciens chefs rebelles livrent leur propre récit — à l’image de la marquise de La Rochejaquelein, dont les Mémoires connaissent une large diffusion. Puis, à mesure que disparaît cette génération de témoins, la Vendée cesse peu à peu d’être un récit de survivants pour devenir un objet d’histoire. Nourrie par les mémorialistes, cette histoire est alors vue par certains comme une instrumentalisation royaliste, dans cette période charnière du début du XIXe siècle.
L’historien Reynald Secher, hérault de la réhabilitation des Vendéens sur la scène historique nationale.
De la mémoire à l’omerta
Deux grandes écoles se font face dans l’historiographie : le courant jacobin, qui défend la Révolution en occultant sa violence, et le courant contre-révolutionnaire, souvent d’inspiration monarchiste, qui insiste sur l’ampleur de la répression et la spécificité de la Vendée. Entre les deux, selon Jean-Joël Brégeon, existent quelques historiens qui tentent de “rejointoyer” les positions adverses pour comprendre de façon scientifique cette révolte si étonnante.
Si l’historiographie “blanche” (contrerévolutionnaire) a pu régner au début du XIXe siècle, elle sera balayée par l’installation de la gauche à l’université, qui impose peu à peu à la fin du siècle sa lecture de l’histoire. C’est ainsi que la Vendée devient un sujet tabou dans le récit national, et que seuls quelques historiens marginaux osent encore en contester la version officielle.
Il y a quarante ans, Reynald Secher soutenait sa thèse de doctorat d’état sur les guerres de Vendée, affirmant l’existence d’une politique d’extermination menée par la Convention. Ce travail, longtemps relégué aux marges de l’historiographie, allait déclencher une violence intellectuelle et médiatique de tous les instants.
Secher raconte avoir été la cible d’une stratégie visant à le discréditer socialement, intellectuellement et financièrement. Ses recherches furent attaquées par des universitaires et des journalistes : certains prétendaient qu’il n’était pas docteur, d’autres que sa thèse n’avait aucune valeur scientifique, qu’il aurait falsifié des documents et n’aurait jamais consulté les archives. Privé d’invitations aux colloques et tenu bien à l’écart par les médias dominants, il ne put jamais défendre ses conclusions dans les cadres consacrés.
Entre campagnes diffamatoires dans le Monde et Libération, exclusion des librairies, menaces physiques lors de salons ou de manifestations, et parfois même gifles et crachats, l’écrivain “maudit” subit la rage de ses contempteurs. Ils considéraient que parler de génocide pour la Vendée revenait à proférer un propos “d’extrême droite” et pouvait dangereusement relativiser la Shoah.
L’historien Reynald Secher, hérault de la réhabilitation des Vendéens sur la scène historique nationale.
Au milieu de cette furie médiatique, certains journaux régionaux, comme Presse Océan, mais aussi nationaux, à l’instar du Figaro Magazine sous la plume de Louis Pauwels, apportèrent leur soutien aux travaux de Reynald Secher. Plus tard, des figures telles que le journaliste de gauche Pierre Péan se mirent à écrire sur la Vendée, reconnaissant dans son cas « une tache pour la République ».
Les guerres de Vendée ont été enfin réévaluées dans l’historiographie, apparaissant comme une page sombre de notre histoire à l’aune des archives. Le récit contre-révolutionnaire n’est désormais plus totalement bafoué par le monde académique. Les travaux d’histoire ont ouvert la voie à des juristes tels Jacques Villemain, spécialiste des génocides dans le monde (en particulier ceux au Rwanda et en Arménie), qui ont pu affirmer que la République avait commis un génocide en Vendée, offrant une définition juridique à ce qui n’avait été jusque-là qu’un débat mémoriel puis historique.
NDLR SN : pour acheter les livres de Reynald Secher cliquez ici
11:44 Publié dans Revue de presse, Un peu d'Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
dimanche, 28 décembre 2025
Décivilisation : quand nos sociétés s’effondrent de l’intérieur

Gautier Cruchaudet
Qu’est-ce que la décivilisation, ce concept invoqué il y a deux ans en conseil des ministres par le chef de l’État lui-même pour qualifier la flambée des violences dans le pays ? S’inscrivant dans la filiation intellectuelle de Gramsci et de Norbert Elias, le politologue Gaël Brustier* émet l’hypothèse que l’effondrement économique, social et sécuritaire des sociétés occidentales serait le paravent d’une crise civilisationnelle plus profonde encore. La crise financière de 2008 sonne le glas des promesses heureuses du néolibéralisme et constitue le ferment du populisme qui portera au pouvoir Giorgia Meloni en Italie et Donald Trump aux États-Unis.
L’affaissement de ce que Brustier nomme le « bloc historique » trouve sa genèse dans l’incapacité des élites à proposer un récit capable d’unir la société par un imaginaire commun et un modèle économique profitable à tous – ce que Gramsci appelait le « national-populaire ». Au rebours de l’« intellectuel organique », qui traduit en revendications politiques les aspirations des masses, nos élites, coupées du peuple, tentent d’imposer par le haut leur propre récit. Incapables de construire un bloc historique, elles s’en remettent vainement au passé : ainsi de la panthéonisation de Robert Badinter ou de la promotion posthume d’Alfred Dreyfus au rang de général de brigade.
Débats hystérisés, diabolisation de l’adversaire
Ancien conseiller d’Arnaud Mon- tebourg et de Julien Dray, Brustier pointe également l’échec d’une gauche inapte à offrir une vision du monde depuis la « trahison mitterrandienne » de 1983 : le Parti socialiste, reniant son axiome social pour embrasser la mondialisation et le fédéralisme européen, plonge définitivement dans l’anti-intellectualisme sous le quinquennat Hollande.
Les symptômes de la décivilisation sont nombreux : appauvrissement des idées, brutalisation du débat public (le polémiste a supplanté l’intellectuel), complaisance envers la violence politique – conduisant les défenseurs auto-proclamés de la tolérance à danser sur le cadavre de Jean-Marie Le Pen –, « césarisme » écologique ou sanitaire niant toute remise en cause des dogmes dominants. Théoricien de l’« hégémonie culturelle », Gramsci appelait les intellectuels à mener une « guerre de position » afin de conquérir le cœur du peuple et exhortait les élites poli- tiques au « compromis historique ». Nous sommes à l’exact opposé : un marasme politico-médiatique fait de débats hystérisés sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision, de caricatures et de diabolisation systématique de l’adversaire.
« La crise consiste justement dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître », écrivait Antonio Gramsci dans ses Cahiers de prison. Pour sortir de cette impasse, Brustier esquisse quelques pistes : un conservatisme du savoir et de l’apprentissage, une recherche de concorde au sein des formations politiques, une forme d’autogestion citoyenne d’inspiration post-libérale. Un programme relativement simple, en somme : retrouver le goût de la nuance, de la rigueur intellectuelle et de l’ouverture d’esprit.
(*) Gaël Brustier, La route de la décivilisation, Ed. du cerf
Source : Le Journal du dimanche
05:32 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
samedi, 27 décembre 2025
Baromètre politique : Sarah Knafo signe la plus forte hausse de toutes les personnalités politiques
Emma Ray Opinion internationale cliquez ici
Sarah Knafo signe une percée spectaculaire dans le dernier baromètre politique Verian pour Le Figaro Magazine. Avec une côte d’avenir désormais établie à 18 %, l’eurodéputée Reconquête enregistre la plus forte hausse de l’ensemble des personnalités politiques testées, gagnant trois points en un mois. En un temps record, elle se hisse à la 12e place du classement, devançant des figures installées comme Jean-Luc Mélenchon, Rachida Dati ou François Hollande, dans un contexte pourtant globalement défavorable à de nombreux leaders nationaux.
Cette progression tranche avec la dynamique observée chez d’autres responsables politiques majeurs, dont plusieurs enregistrent un recul notable. Marine Le Pen, Jordan Bardella ou encore Marion Maréchal voient leur cote fléchir, tandis que Sarah Knafo apparaît comme l’une des rares figures à capter une attente nouvelle dans l’opinion. Le phénomène se confirme également dans un autre indicateur clé : selon un récent sondage IFOP sur le souhait de candidature en 2027, elle enregistre là encore la plus forte hausse, avec cinq points supplémentaires, atteignant 18 % d’opinions favorables à une candidature présidentielle.
Cette dynamique s’explique en partie par une exposition médiatique particulièrement efficace. Le passage de Sarah Knafo mercredi 10 décembre dans l’émission de Pascal Praud sur CNEWS a marqué les esprits, tant par le contenu que par l’audience. L’émission a franchi le cap symbolique du million de téléspectateurs, culminant à plus de 1,24 million, écrasant la concurrence sur la tranche horaire. Une performance rare qui confirme l’attractivité du personnage et de son discours auprès d’un public de plus en plus large.
Profitant de cette exposition, l’eurodéputée a livré un plaidoyer offensif sur la gestion de l’audiovisuel public, appelant à sa privatisation et dénonçant ce qu’elle décrit comme une dérive budgétaire déconnectée des priorités des Français. Un discours clivant, assumé, mais qui semble rencontrer un écho certain, à en juger par les réactions et la couverture médiatique qui ont suivi.
Ce succès n’est pas isolé. Dès septembre, Sarah Knafo avait déjà battu un record historique d’audience dans l’émission de Sonia Mabrouk, La Grande ITW, dépassant les 630 000 téléspectateurs, un niveau jamais atteint auparavant. À la croisée des sondages et des audiences, la trajectoire de l’eurodéputée dessine désormais celle d’un phénomène politique et médiatique, dont la montée en puissance s’impose comme l’un des faits marquants de la séquence politique de l’année 2025.
11:24 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
Nationalisme breton : un hors-série de "Bretons" très léger, orienté, et historiquement déséquilibré
Yann V. Breizh Info cliquez ici
Le nouveau hors-série du magazine Bretons, consacré à l’histoire du nationalisme breton, ambitionne de répondre à une question séduisante : la Bretagne serait-elle une « terre d’insoumission » cliquez ici ? Sur le papier, le sujet est légitime. Dans les faits, le traitement proposé pose de sérieux problèmes de méthode, d’équilibre et de rigueur historique.
Une obsession pour la Seconde Guerre mondiale… pour mieux relativiser
Premier malaise : l’obsession manifeste pour la période de la Seconde Guerre mondiale. La couverture, le choix iconographique et une large partie du propos ramènent constamment le lecteur à ces années noires, comme si le nationalisme breton ne pouvait être envisagé qu’à travers ce prisme. Or, paradoxe troublant, le magazine passe ensuite beaucoup de temps à expliquer que ce nationalisme-là fut marginal, insignifiant, presque anecdotique.
Difficile, dès lors, de comprendre la logique éditoriale : pourquoi faire de cette séquence le cœur visuel et narratif du numéro, sinon pour provoquer, vendre du papier et rassurer un lectorat habitué à associer toute affirmation identitaire à une faute morale originelle ? Ce choix entretient une confusion permanente entre contextualisation historique et mise en accusation implicite.
Une histoire amputée de ses racines profondes
Autre faiblesse majeure : tout ce qui touche à l’histoire bretonne est traité de manière superficielle – certes, c’est un format magazine mais quand même. La période ducale, les continuités politiques et juridiques, la lente intégration dans l’ensemble français, les résistances culturelles et linguistiques de long terme : autant de thèmes survolés, quand ils ne sont pas réduits à quelques paragraphes convenus.
Pour un numéro prétendant retracer « l’histoire des nationalistes bretons », cette légèreté est problématique. Les lecteurs déjà informés n’y apprendront strictement rien. Quant aux lecteurs curieux ou profanes, ils repartent avec une vision tronquée, où le nationalisme breton semble surgir presque ex nihilo au XXᵉ siècle, sans véritable profondeur historique.
Un regard idéologiquement marqué sur l’Emsav contemporain
Le biais idéologique apparaît plus nettement encore dans le traitement de la période contemporaine. Les mouvements, partis et acteurs classés à gauche bénéficient de portraits globalement bienveillants, parfois complaisants. À l’inverse, ceux situés à droite ou à l’extrême droite sont présentés sous un jour négatif, soupçonneux, voire disqualifiant.
Le déséquilibre est d’autant plus frappant que le magazine accorde une place centrale à des sociologues, chercheurs et analystes explicitement situés à gauche, présentés comme des autorités quasi incontestables. Leurs grilles de lecture sont rarement confrontées à des approches divergentes, enracinées, historicistes ou non progressistes. La neutralité revendiquée n’est donc qu’apparente.
Il suffit, pour s’en convaincre, de parcourir la bibliographie mobilisée. Les références convoquées relèvent massivement d’un même courant idéologique, au détriment d’auteurs majeurs de l’historiographie bretonne, de travaux plus anciens, ou de lectures critiques du nationalisme contemporain. A aucun moment par exemple, les travaux d’Yves Mervin ne viennent se superposer à ceux de Kristian Hamon, sur la Seconde guerre mondiale. Ce choix conditionne mécaniquement le récit proposé et limite fortement la pluralité des interprétations.
Un magazine grand public, mais à quel prix ?
Certes, Bretons est un magazine grand public, au format accessible. Mais cette contrainte n’excuse pas tout. Vulgariser n’implique pas de simplifier jusqu’à la déformation, ni d’orienter subtilement le lecteur vers une lecture politiquement confortable. En l’état, ce hors-série ne fait ni œuvre de transmission sérieuse, ni véritable travail d’analyse.
Au final, ce numéro spécial sur le nationalisme breton laisse une impression de rendez-vous manqué. Trop centré sur une période obsessionnelle, trop léger sur les fondements historiques de la Bretagne, trop indulgent avec les acteurs de gauche de l’Emsav et trop sévère avec les autres, il produit un récit biaisé, au sens strict du terme.
Les connaisseurs resteront sur leur faim. Les lecteurs néophytes, eux, risquent surtout d’intégrer une vision partielle et idéologiquement orientée d’une histoire bretonne pourtant riche, complexe et profondément enracinée. Une Bretagne réduite à quelques clichés commodes, là où elle méritait mieux.
11:09 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
Ce que cache le harcèlement judiciaire contre le révisionniste Vincent Reynouard
Jérôme Viguès Riposte laïque cliquez ici
Depuis plusieurs années, un glissement discret mais profond s’opère dans le rapport entre la justice et la dissidence intellectuelle. Officiellement, rien n’a changé : la justice continue d’affirmer qu’elle ne juge que des faits, jamais des opinions. Dans les textes, le principe demeure intangible. Dans la pratique, pourtant, de plus en plus d’affaires montrent que la frontière entre l’acte et l’idée s’est considérablement brouillée.
Le cas Vincent Reynouard s’inscrit pleinement dans ce mouvement. Il ne s’agit pas ici de discuter la validité ou la fausseté de ses thèses, ni d’entrer dans un débat historique ou moral, mais d’observer la logique juridique à l’œuvre : ce qui est désormais poursuivi, ce n’est plus un comportement matériel classique, mais la persistance d’un discours jugé incompatible avec l’ordre symbolique établi. La justice ne se contente plus de sanctionner une infraction ponctuelle ; elle s’inscrit dans une logique de neutralisation durable d’un individu au motif que ses idées, répétées, structurées, cohérentes, constituent en elles-mêmes une menace. Ce basculement est fondamental. Il marque le passage d’une justice de l’acte à une justice de l’intention, puis à une justice de l’opinion stabilisée.
Reynouard n’est pas poursuivi pour avoir commis un acte de violence, pour avoir organisé un réseau criminel ou pour avoir porté atteinte physiquement à quiconque, mais pour avoir maintenu, contre vents et marées, un corpus idéologique interdit. La justice considère alors que la constance même de ce discours devient un acte en soi. C’est précisément ce raisonnement qui mérite d’être interrogé, non pour défendre l’homme ou ses thèses, mais pour comprendre le précédent qu’il crée. Car une fois que l’on accepte que la répétition d’une opinion constitue un délit autonome, indépendamment de toute action matérielle, on ouvre un champ d’application potentiellement infini. Aujourd’hui, ce raisonnement s’applique à un négationniste unanimement rejeté dans l’espace public. Demain, rien n’interdit qu’il s’étende à d’autres formes de dissidence idéologique, dès lors qu’elles seront qualifiées de dangereuses pour la cohésion sociale, l’ordre public ou la stabilité démocratique. Ce qui rend ce type de dossier particulièrement structurant, ce n’est pas tant la personnalité de l’individu concerné que la manière dont le droit justifie, encadre et légitime l’intervention judiciaire.
Depuis plusieurs décennies, le droit européen a progressivement déplacé le centre de gravité de la liberté d’expression. On ne se contente plus de vérifier si un propos appelle explicitement à la violence ou à un passage à l’acte, on évalue désormais son potentiel de nuisance abstraite, sa capacité supposée à altérer la cohésion sociale, à nourrir des haines latentes ou à fragiliser un consensus historique, moral ou politique. La parole n’est plus considérée comme une simple opinion exprimée dans l’espace public, mais comme un fait social produisant des effets diffus, différés, parfois impossibles à mesurer concrètement mais néanmoins présumés réels. C’est sur ce terrain que la justice s’autorise à intervenir non pas après un dommage clairement identifié, mais en amont, au nom de la prévention. Ce raisonnement est juridiquement cohérent dans son architecture interne, mais politiquement lourd de conséquences. Car il transforme la justice en arbitre du dicible légitime, chargé de déterminer non seulement ce qui est faux ou vrai au regard de la loi, mais aussi ce qui est acceptable, tolérable ou dangereux pour la collectivité.
La répétition d’un discours interdit devient alors une circonstance aggravante, non parce qu’elle entraîne un préjudice mesurable, mais parce qu’elle manifeste une obstination idéologique interprétée comme une volonté de nuire. La constance d’une pensée est assimilée à une intention délictueuse. La sanction ne vise plus à corriger un comportement ponctuel, mais à briser une persévérance intellectuelle. À partir du moment où ce cadre est admis, une dynamique d’extension devient presque mécanique. Les dispositifs d’exception ne restent jamais confinés à leur cible initiale. Ils s’élargissent, se déplacent. Le traitement judiciaire réservé aujourd’hui à un négationniste unanimement disqualifié fonctionne comme un laboratoire, précisément parce qu’il ne suscite ni empathie ni solidarité transversale. Une société qui accepte que la justice sanctionne un individu non pour ce qu’il fait mais pour ce qu’il persiste à penser crée un précédent qui dépasse largement le cas initial. L’islamophobe pourra être poursuivi pour avoir entretenu un climat de rejet, le climato-sceptique pour avoir diffusé une vision du monde jugée contraire à l’intérêt général. La justice ne dira jamais qu’elle punit une opinion, mais qu’elle sanctionne un discours aux effets indirects, cumulatifs et systémiques.
Ce glissement se fait sans brutalité apparente, sans censure explicite, par accumulation de décisions présentées comme raisonnables, proportionnées et nécessaires. La dissidence reste tolérée tant qu’elle est marginale, fluctuante ou superficielle. Ce qui est visé, c’est la dissidence persistante, assumée, structurée, celle qui refuse l’autocensure. Les médias accompagnent ce mouvement en réduisant certains individus à des étiquettes qui dispensent d’examiner le fond. Le jugement précède l’analyse. La décision judiciaire devient la formalisation d’un consensus moral déjà acquis. La société accepte alors que la justice tranche à sa place sur ce qui peut être soutenu durablement dans l’espace public. Le recours au juge devient une solution de confort pour éviter le débat et la confrontation intellectuelle. On ne réfute plus, on neutralise. Une démocratie solide se reconnaît moins à sa capacité à faire taire ses marginaux qu’à sa faculté à supporter des discours qu’elle juge erronés sans se dissoudre pour autant. Lorsque la justice commence à sanctionner la cohérence idéologique plus que le passage à l’acte, elle cesse d’être le juge des actes pour devenir le gardien des consciences.
Sur le sujet, lire aussi l'article de Balbino Katz publié sur Breizh Info cliquez là
10:58 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
mardi, 23 décembre 2025
La haine contre Noël : le nouveau dogme d’une gauche qui se déteste

Balbino Katz
La politique, ces jours-ci, se ralentit, s’alanguit, semble retenir son souffle. Les grandes machines institutionnelles tournent à vide, les mots usés ne mordent plus sur le réel. Dans ces périodes d’atonie, on peut presque faire confiance aux histrions de gauche pour créer des conflits là où il ne devrait pas y en avoir, comme si la discorde tenait lieu d’activité intellectuelle de remplacement.
Ce matin, à la table de ma cuisine, entre deux gorgées de café, je parcourais Libération. Je suis tombé sur un texte signé par Paul B. Preciado, écrivain trans présenté par le journal comme philosophe. L’auteur fut autrefois une femme avant de décider qu’il était un homme. Ce fait, en soi, n’appellerait aucun commentaire s’il ne devenait la clé de voûte d’un système de pensée entier, projeté ensuite sur le monde comme une grille d’interprétation universelle.
L’article s’en prend à Noël. Le ton n’est ni celui d’une critique mesurée ni celui d’une analyse culturelle. Il s’agit d’un réquisitoire. Certaines remarques pourraient pourtant être partagées sans peine. La marchandisation excessive de la fête, son formatage par l’industrie culturelle américaine, la réduction de rites anciens à des objets de consommation, tout cela mérite d’être dit et l’a déjà été, souvent avec plus de finesse. Le cœur du texte n’est pas là.
Ce qui frappe, c’est l’acharnement à faire de Noël un objet intrinsèquement coupable. Pour Preciado, la fête serait un culte chrétien et nationaliste de la famille, un dispositif d’oppression, une mise en scène normative destinée à écraser les identités dissidentes. On retrouve ici la mécanique bien rodée de la déconstruction sociale, qui consiste à nier l’existence d’une norme commune pour la remplacer par une mosaïque de singularités sacralisées.
C’est à cet endroit précis qu’apparaît l’idée centrale, trop souvent laissée dans l’ombre, celle de la norme majoritaire conçue comme maladie. Le terme de « normopathe », employé sans la moindre hésitation, mérite qu’on s’y arrête. Il dit plus que de longs discours. Être conforme à l’ordre humain majoritaire, partager les traits, les habitudes, les structures familiales et symboliques de la majorité, ne relève plus du simple fait anthropologique. Cela devient une pathologie. La normalité est médicalisée, psychologisée, criminalisée presque. L’écart n’est plus un accident ou une épreuve, il devient une supériorité morale. La majorité, elle, est sommée de s’excuser d’exister.
Dans cette logique, l’infirmité disparaît comme réalité tragique pour être rebaptisée « diversité fonctionnelle ». Le mot soigne la blessure en niant son existence. La biologie cesse d’être un fait pour devenir une opinion parmi d’autres. Est femme celui ou celle qui se dit femme, est homme celui ou celle qui se dit homme, indépendamment de toute réalité charnelle. Le langage prétend commander au réel, et le réel, lorsqu’il résiste, est accusé de violence. La norme, autrefois cadre commun, devient l’ennemi.
Les formules employées par l’auteur finissent par dévoiler la nature profonde de son propos. Noël serait « la cruauté de classe, la violence de genre et sexuelle déguisée en cadeau sous le sapin ». Il irait jusqu’à devenir « l’inceste transformé en fête enfantine ». Puis vient l’aveu central, celui qui éclaire l’ensemble du texte, lorsqu’il écrit que, pour les personnes queer ou trans chez les chrétiens, Noël serait le moment du grand reniement de soi. La fête serait intrinsèquement raciste, patriarcale, nationaliste, binaire, commerciale et anti-écologique. Le mot intrinsèquement revient comme un marteau, signe qu’aucune rédemption n’est possible.
Ce texte, en vérité, ne parle pas de Noël. Il parle d’une haine intérieure projetée sur le monde. Il exprime le rejet d’un héritage, d’une continuité, d’un ordre symbolique qui rappelle que l’homme ne se crée pas seul. Or Noël, précisément, rappelle cela. Il rappelle la filiation, la transmission, la famille imparfaite mais réelle, le temps long qui précède et dépasse l’individu.
Noël, pourtant, ne se laisse pas enfermer dans la seule identité chrétienne que ses adversaires lui reprochent. La fête plonge ses racines bien plus profondément, dans notre spiritualité la plus ancienne. Bien avant le christianisme, les peuples d’Europe célébraient le solstice d’hiver, ce moment où la nuit atteint son point extrême avant de céder lentement la place au jour renaissant. Ce basculement cosmique, discret mais décisif, était vécu comme une promesse. On se rassemblait autour du feu, on partageait le pain, on conjurait l’obscurité par des rites simples et charnels. Le christianisme n’a pas effacé cet héritage, il l’a recueilli, baptisé, intégré dans son propre récit. C’est pourquoi Noël parle encore à tous, au-delà des croyances et des dogmes. Il touche une mémoire plus ancienne que les idéologies, une mémoire du corps et du monde.
C’est précisément cette profondeur qui le rend insupportable à ceux qui se sont mis en guerre contre toute forme de continuité. Quand on se déteste au point de vouloir ne plus être ce que l’on est, on finit par haïr tout ce qui rappelle l’ordre dont on est issu. La norme devient une offense, la tradition une violence, la lumière un scandale. Noël, dans ce regard tordu, n’est plus une célébration. Il devient un ennemi.
Source : Breizh.info cliquez ici
10:23 Publié dans Balbino Katz, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |
jeudi, 18 décembre 2025
Entretien avec François Fillon

François Fillon a été le premier à faire les frais d’une justice politique. L’Etat profond ne voulait pas le voir devenir président de la République. Cette même justice – aux ordres de l’Etat profond toujours – a ensuite pris pour cible Marine Le Pen, pour les mêmes raisons que François Fillon, et a réglé ses comptes avec Nicolas Sarkozy qui avait osé mettre en doute leur champs de compétence voire leur légitimité. Dans cet entretien, l’ex-Premier ministre jette un regard lucide sur le chaos qui règne aujourd’hui dans notre pays.
Lire la suite ICI
Source : Le Figaro 18/12/2025
11:07 Publié dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
| ![]() Facebook | |
Facebook | |